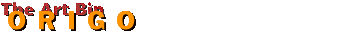

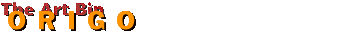 |
|
 | |

| Discours Préliminaire de l'Encyclopédie |
| Jean Le Rond d'Alembert, 1751 (edition Wieleitner, 1911) |

| Deuxième Partie.
Nous allons présentement considérer cet ouvrage comme dictionnaire raisonné des sciences et des arts. L'objet est d'autant plus important, que c'est sans doute celui qui peut intéresser davantage la plus grande partie de nos lecteurs, et qui, pour être rempli, a demandé le plus de soins et de travail. Mais, avant d'entrer, sur ce sujet, dans tout le détail qu'on est en droit d'exiger de nous, il ne sera pas inutile d'examiner avec quelque étendue l'état présent des sciences et des arts, et de montrer par quelle gradation on y est arrivé. L'exposition métaphysique de l'origine et de la liaison des sciences nous a été d'une grande utilité pour en former l'arbre encyclopédique; l'exposition historique de l'ordre dans lequel nos connaissances se sont s u c cé d é, ne sera pas moins avantageuse p our no us éclairer nous-mêmes sur la manière dont nous devons transmettre ces connaissances à nos lecteurs. D'ailleurs, I'histoire des sciences est naturellement liée ~i celle du petit nombre de grands génies dont les ouvrages ont contribué à répandre la lumière parmi les hommes, et, ces ouvrages ayant fourni pour le nôtre les secours généraux, nous devons comnencer à en parler avant de rendre compte des secours particuliers que nous avons obtenus. Pour ne point remonter trop haut, fixonsnous à la renaissance des lettres.
Quand on considère les progrès de l'esprit depuis cette époque mémorable, on trouve que ces progrès se sont faits dans l'ordre qu'ils devaient naturellement suivre. On a commencé par l'érudition, continué par les belles-lettres, et fini par la philosophie. Cet ordre diffère à la vérité de celui que doit observer l'homme abandonné à ses propres lumières, ou borné au commerce de ses contemporains, tel que nous l'avons principalement considéré dans la première partie de ce discours : en effet, nous avons fait voir que l'esprit, isolé doit rencontrer dans sa route la philosophie avant les belles-lettres. Mais en sortant d'un long intervalle d'ignorance que des siècles de lumière avaient précédé, la régénération des idées, si on peut parler ainsi, a dû necessairement être différente de leur génération primitive. Nous allons tâcher de le faire sentir.
Les chefs-d'oeuvre que les anciens nous avaient laissés dans presque tous les genres avaient été oublies pendant douze siècles. Les principes des sciences et des arts étaient perdus, parce que le beau et le vrai,; qui semblent se montrer de toutes parts aux hommes, ne les frappent guère à moins qu'ils n'en soient avertis. Ce n'est pas que ces temps malheureux aient été plus stériles que d'autres en génies rares; la nature est toujours la même; mais que pouvaient faire ces grands hommes, semés de loin en loin comme ils le sont toujours, occupés d'objets différents et abandonnés sans culture à leurs seules lumières? Les idées qu'on acquiert par la lecture et par la société sont le germe de presque toutes les découvertes. C'est un air que l'on respire sans y penser, et auquel on doit la vie; et les ho,nmes dont nous parlons étaient privés d'un tel secours. Ils ressemblaient aux premiers créateurs des sciences et des arts, que leurs illustres successeurs ont fait oublier, et qui, précédés par ceuxci, les auraient fait oublier de même. Celui qui trouva le premier les roues et les pignons eût inventé les montres dans un autre siècle, et Gerbert, placé au temps d'Archimède, l'aurait peut-être égalé.
Cependant la plupart des beaux esprits de ces temps ténébreux se faisaient appeler poètes ou philosophes. Que leur en coûtait-il, en effet, pour usurper deux titres dont on se pare à si peu de frais, et qu'on se flatte toujours de ne guère devoir à des lumières empruntées? Ils croyaient qu'il était inutile de chercher les modèles de la poésie dans les ouvrages des Grecs et des Romains, dont la langue ne se parlait plus; et ils prenaient pour la véritable philosophie des anciens une tradition barbare qui la défigurait. La poésie se réduisait pour eux à un mécanisme puéril et l'examen approfondi de la nature et la grande étude de l'homme étaient remplacés par mille questions frivoles sur des êtres abstraits et métaphysiques; questions dont la solution, bonne ou mauvaise, demandait souvent beaucoup de subtilité, et, par conséquent, un grand abus de l'esprit. Qu'on joigne à ce désordre l'état d'esclavage où presque toute l'Europe était plongée, les ravages de la superstition qui naît de l'ignorance, et qui la reproduit à son tour, et on verra que rien ne manquait aux obstacles qui éloignaient le retour de la raison, et du goût; car il n'y a que la liberté d'agir et de penser qui soit capable de produire de grandes choses, et elle n'a besoin que de lumières pour se préserver des excès.
Aussi fallut-il au genre humain, pour sortir de la barbarie, une de ces révolutions qui font prendre à la terre une face nouvelle: l'Empire grec est détruit, sa ruine fait refluer en Europe le peu de connaissances qui restaient encore au monde: l'invention de l'imprimerie, la protection des Médicis et de François Ier raniment les esprits, et la lumière renait de toutes parts.
L'étude des langues et de l'histoire, abandonnée par nécess ité durant les siècles d' ignorance, fut la première à laquelle on se livra. L'esprit humain se trouvait, au sortir de la barbarie, dans une espèce d'enfance, avid e d' accumuler d es idé es, et incapable pourtant d'en acquérir d'abord d'un certain ordre par l'espèce d'engourdissement où les facultés de l'âme avaient été si longtemps. De toutes ces facultés, la m émoire fut celle que l'on cultiva d'abord, parce qu'elle est la plus facile à satisfaire, et que les connaissances qu'on obtient par son secours sont celles qui peuvent le plus aisément être entassées On ne commensa donc point par étudier la nature, ainsi que les premiers hommes avaient dû faire: on jouissait d'un secours dont ils étaient dépourvus, celui des ouvrages des anciens, que, la générosité des grands et l'impression commensaient à rendre communs: on croyait n'avoir qu'à lire pour devenir savant; et il est bien plus aisé de lire que de voir. Ainsi, on dévora sans distinction tout ce que les anciens nous avaient laissé dans chaque genre: on les traduisit, on les commenta; et, par une espèce de reconnaissance, on se mit à les adorer, sans connaitre, à beaucoup près, ce qu'ils valaient.
De là cette foule d'érudits profonds dans les langues savantes, jusqu'à dédaigner la leur, qui, comme l'a dit un auteur célèbre, connaissaient tout dans les anciens, hors la grâce et la finesse, et qu'un vain étalage d'érudition rendait si orgueilleux; parce que les avantages qui coûtent le moins sont pour l'ordinaire ceux dont on aime le plus à se parer. C'était une espèce de grands seigneurs, qui, sans ressembler par le mérite réél à ceux dont ils tenaient la vie, tiraient beaucoup de vanité de croire leur appartenir. D'ailleurs, cette vanité n'était point sans quelque espèce de prétexte. Le pays de l'érudition et des faits est inépui sable; on croit, pour ainsi dire, voir tous les jours augmenter sa substance par les acquisitions que l'on y fait sans peine. Au contraire, le pays de la raison et des découvertes est d'une assez petite étendue; et souvent, au lieu d'y apprendre ce que l'on ignorait, on ne parvient à force d'étude qu'à désapprendre ce qu'on croyait savoir. C'est pourquoi, à mérite fort inégal, un érudit doit être beaucoup plus vain qu'un philosophe, et peut-être qu'un poète: car l'esprit qui invente est toujours mécontent de ses progrès, parce qu'il voit au delà; et les plus grands génies trouvent souvent dans leur amour-propre même un juge secret mais sévère, que l 'approb ation des autres fait ta ire pour quelques instants, mais qu'elle ne parvient jamais à corrompre. On ne doit donc pas s'étonner que les savants dont nous parlons missent tant de gloire à jouir d'une science hérissée, souvent ridicule, et quelquefois barbare.
Il est vrai que notre siècle, qui se croit destiné à changer les lois en tout genre, et à faire justice, ne pense pas fort avantageusement-de ces hommes autrefois si célèbres. C'est une espèce de mérite aujourd'hui que d'en faire peu de cas; et c'est même un mérite que bien des gens se contentent d'avoir. Il semble que, par le mépris qu'on a pour ces savants, on cherche à les punir de l'estime outrée qu'ils faisaient d'eux-mêmes, ou du suffrage peu éclairé de leurs contemporains, et qu'en foulant aux pieds ces idoles, on veuille en faire oublier jusqu'aux noms. Mais tout excès est injuste. Jouissons plutôt avec reconnaissance du travail de ces hommes laborieux. Pour nous mettre à portée d'extraire des ouvrages des anciens tout ce qui pouvait nous être utile, il a fallu qu'ils en tirassent aussi ce qui ne l'était pas; on ne saurait tirer l'or d'une mine sans en faire sortir en même temps beaucoup de matières viles ou moins précieuses; ils auraient fait comme nous la séparation, s'ils étaient venus plus tard. L'érudition était donc nécessaire pour nous conduire aux belles-lettres.
En effet, il ne fallut pas se livrer longtemps à la lecture des anciens, pour se convaincre que, dans ces ouvrages mêmes où l'on ne cherchait que des faits ou des mots, il y avait mieux à apprendre. On aperçut bientôt les beautés que leurs auteurs y avaient répandues; car si les hommes, comme nous l'avons dit plus . haut, ont besoin d'être avertis du vrai, en récompense ils n'ont besoin que de l'être. L'admiration qu'on avait eue jusqu'alors pour les anciens ne pouvait être plus vive; mais elle commença à devenir plus juste: cependant elle était encore bien loin d'être raisonnable. On . crut qu'on ne pouvait les imiter qu'en les copiant servilement, et qu'il n'était possible de bien dire que dans leur langue. On ne pensait pas que l'étude des mots est une espèce d'inconvénient passager, nécessaire pour faciliter l'étude des choses, mais qu'elle devient un mal réel quand elle retarde cette étude; qu'ainsi on aurait dû se borner à se rendre familiers les auteurs grecs et romains, pour profiter de ce qu'ils avaient pensé de meilleur; et que le travail auquel il fallait se livrer pour écrire leur langue était autant de perdu pour l'avancement de la raison. On ne voyait pas d'ailleurs que, s'il y a dans les anciens un grand nombre de beautés de style perdues pour nous, il doit y avoir aussi, par la même raison, bien des défauts qui échappent, et que l'on court risque de copier comme des beautés; qu'enfin tout ce qu'on pourrait espérer par l'usage servile de la langue des anciens, ce serait de se faire un style bizarrement assorti d'une infinité de styles différents, très correct et admirable même pour nos modernes, mais que Cicéron ou Virgile auraient trouvé ridicule. C'est ainsi que nous ririons d'un ouvrage écrit en notre langue, et dans lequel l'auteur aurait rassemblé des phrases de Bossuet, de La Fontaine, de La Bruyère et de Racine, persuadé avec raison que chacun de ces écrivains en particulier est un excellent modèle.
Ce préjugé des premiers savants a produit dans le seizième siècle une foule de poètes, d'orateurs et d'historiens latins, dont les ouvrages, il faut l'avouer, tirent trop souvent leur principal mérite d'une latinité dont nous ne pouvons guère juger. On peut en comparer quelques-uns aux harangues de la plupart de nos rhéteurs, qui, vides de choses, et semblables à des corps sans substance, n'auraient besoin que d'être mises en français pour n'être lues de personne.
Les gens de lettres sont enfin revenus peu à peu de cette espèce de manie. Il y a apparence qu'on doit leur changement, du moins en partie, à la protection des grands, qui sont bien aises d'être savants, à condition de le devenir sans peine, et qui veulent pouvoir juger sans étude d'un ouvrage d'esprit, pour prix des bienfaits qu'ils promettent à l'auteur, ou de l'amitié dont ils croient l'honorer. On commença à sentir que le beau, pour être en langue vulgaire, ne perdait rien de ses avantages; qu'il acquérait même celui d'être plus facilement saisi du commun des hommes, et qu'il n'y avait aucun mérite à dire des choses communes ou ridicules dans quelque langue que ce fût, et à plus forte raison dans celles qu'on devait parler le plus mal. Les gens de lettres pensèrent donc à perfectionner les langues vulgaires; ils cherchèrent d'abord à dire dans ces langues ce que les anciens avaient dit dans les leurs. Cependant, par une suite du préjugé dont on avait eu tant de peine à se défaire, au lieu d'enrichir la langue française, on commença par la défigurer. Ronsard en fit un jargon barbare, hérissé de grec et de latin; mais heureusement il la rendit assez méconnaissable pour qu'elle en devînt ridicule. Bientôt on sentit qu'il fallait transporter dans notre langue les beautés et non les mots des langues anciennes. Réglée et perfectionnée par le goût, elle acquit assez promptement une infinité de tours et d'expressions heureuses. Enfin, on ne se borna plus à copier les Romains et les Grecs, ou même à les imiter, on tâcha de les surpasser, s'il était possible, et de penser d'après soi. Ainsi, l'imagination des modernes renaquit peu à peu de celle des anciens; et on vit éclore presqu'en même temps tous les chefs-d'oeuvre du dernier siècle, en éloquence, en histoire, en poésie, et dans les différents genres de littérature.
Malherbe, nourri de la lecture des excellents poètes de l'antiquité, et prenant comme eux la nature pour modèle, répandit le premier dans notre poésie une harmonie et des beautés auparavant inconnues. Balzac, aujourd'hui trop méprisé, donna à notre prose de la noblesse et du nombre. Les écrivains du Port-Royal continuèrent ce que Balzac avait commencé; ils y ajoutèrent cette précision, cet heureux choix des termes, et cette pureté qui ont conservé jusqu'à présent, à la plupart de leurs ouvrages, un air moderne, et qui les distingue d'un grand nombre de livres surannés, écrits dans le même temps. Corneille, après avoir sacrifié pendant quelques années au mauvais goût dans la carrière dramatique, s'en affranchit enfin, découvrit par la force de son génie, bien plus que par la lecture, les lois du théâtre, et les exposa dans ses discours admirables sur la tragédie, dans ses réflexions sur chacune de ses pièces, mais principalement dans ses pièces mêmes. Racine, s'ouvrant une autre route, fit paraître sur le théâtre une passion que les anciens n'y avaient guère connue, et développant les ressorts du coeur humain, joignit à une élégance et une vérité continues quelques traits de sublime. Despréaux, dans son Art poétique, se rendit l'égal d'Horace en l'imitant. Molière, par la peinture fine des ridicules et des moeurs de son temps, laissa loin derrière lui la comédie ancienne. La Fontaine fit presque oublier Ésope et Phèdre, et Bossuet alla se placer à côté de Démosthènes.
Les beaux-arts sont tellement unis avec les belleslettres, que le même goût qui cultive les unes porte aussi à perfectionner les autres. Dans le même temps que notre littérature s'enrichissait par tant de beaux ouvrages, Poussin faisait ses tableaux, et Puget ses statues; Le Sueur peignait le cloître des Chartreux, et Lebrun les batailles d'Alexandre; enfin Quinault, créateur d'un nouveau genre, s'assurait l'immortalité par ses poèmes lyriques et Lully donnait à notre musique naissante ses premiers traits.
Il faut avouer pourtant que la renaissance de la peinture et de la sculpture avait été beaucoup plus rapide que celle de la poésie et de la musique; et la raison n'en est pas difficile à apercevoir. Dès qu'on commença à étudier les ouvrages des anciens en tout genre, les chefs- d' oeuvre antiques, qui avaient échappé en assez grand nombre à la superstition et à la barbarie, frappèrent bientôt les yeux des artistes éclairés; on ne pouvait imiter les Praxitèle et les Phidias qu'en faisant exactement comme eux; et le talent n'avait besoin que de bien voir: aussi Raphaël et Michel-Ange ne furent pas longtemps sans porter leur art à un point de perfection qu'on n'a point encore passé depuis. En général, I'objet de la peinture et de la sculpture étant plus du ressort des sens, ces arts ne pouvaient manquer de précéder la poésie, parce que les sens ont dû être plus promptement affectés des beautés sensibles et palpables des statues anciennes, que l'imagination n'a dû apercevoir les beautés intellectuelles et fugitives des anciens écrivains. D'ailleurs, quand elle a commencé à les découvrir, l'imitation de ces mêmes beautés, imparfaite par sa servitude et par la langue étrangère dont elle se servait, n'a pu manquer de nuire aux progrès de l'imagination même. Qu'on suppose pour un moment nos peintres et nos sculpteurs privés de l'avantage qu'ils avaient de mettre en oeuvre la même matière que les anciens: s'ils eussent, comme nos littérateurs, perdu beaucoup de temps à rechercher et à imiter mal cette matière, au lieu de songer à en employer une autre, pour imiter les ouvrages mêmes qui faisaient l'objet de leur admiration, ils auraient fait sans doute un chemin beaucoup moins rapide, et en seraient encore à trouver le marbre.
A l'égard de la musique, elle a dû arriver beaucoup plus tard à un certain degré de perfection, parce que c'est un art que les modernes ont été obligés de créer. Le temps a détruit tous les modèles que les anciens avaient pu nous laisser en ce genre, et leurs écrivains, du moins ceux qui nous restent, ne nous ont transmis sur ce sujet que des connaissances très obscures, ou des histoires plus propres à nous étonner qu'à nous instruire. Aussi plusieurs de nos savants, poussés peut-être par une espèce d'amour de propriété, ont prétendu que nous avons porté cet art beaucoup plus loin que les Grecs; prétention que le défaut de monuments rend aussi difficile à appuyer qu'à détruire, et qui ne peut être qu'assez faiblement combattue par les prodiges vrais ou supposés de la musique ancienne. Peut-être serait-il permis de conjecturer avec quelque vraisemblance que cette musique était tout à fait différente de la nôtre, et que si l'ancienne était supérieure par la mélodie, l'harmonie donne à la moderne des avantages.
Nous serions injustes si, à l'occasion du détail où nous venons d'entrer, nous ne reconnaissions point ce que nous devons à l'Italie; c'est d'elle que nous avons reçu les sciences, qui, depuis, ont fructifié si abondamment dans toute l'Europe; c'est à elle surtout que nous devons les beaux-arts et le bon goût, dont elle nous a fourni un grand nombre de modèles inimitables.
Pendant que les arts et les belles-lettres étaient en honneur, il s'en fallait beaucoup que la philosophie fit le même progrès, du moins dans chaque nation prise en corps; elle n'a reparu que beaucoup plus tard. Ce n'est pas qu'au fond il soit plus aisé d'exceller dans les belles-lettres que dans la philosophie; la supériorité en tout genre est également difficile à atteindre; mais la lecture des anciens devait contribuer plus promptement à l'avancement des belles-lettres et du bon goût qu'à celui des sciences naturelles. Les beautés littéraires n'ont pas besoin d'être vues longtemps pour être senties; et comme les hommes sentent avant de penser, ils doivent par la même raison juger ce qu'ils sentent avant de juger ce qu'ils pensent. D'ailleurs, les anciens n'étaient pas à beaucoup près aussi parfaits comme philosophes que comme écrivains. En effet, quoique, dans l'ordre de nos idées, les premières opérations de la raison précèdent les premiers efforts de l'imagination, celle-ci, quand elle a fait les premiers pas, va beaucoup plus vite que l'autre: elle a l'avantage de travailler sur des objets qu'elle enfante; au lieu que la raison, forcée de se borner à ceux qu'elle a devant elle, et de s'arrêter à chaque instant, ne s'épuise que trop souvent en recherches infructueuses. L'univers et les réflexions sont le premier livre des vrais philosophes, et les anciens l'avaient sans doute étudié: il était donc nécessaire de faire comme eux; on ne pouvait suppléer à cette étude par celle de leurs ouvrages, dont la plupart avaient été détruits, et dont un petit nombre, mutilés par le temps, ne pouvaient nous donner sur une matière si vaste que des notions fort incertaines et fort altérées.
|

|

| Tant de préjugés, qu'une admiration aveugle pour l'antiquité contribuait à entretenir, semblaient se fortifier encore par l'abus qu'osaient faire quelques théologiens de la soumission des peuples. On avait permis aux poètes de chanter dans leurs ouvrages les divinités du paganisme, parce qu'on était persuadé, avec raison, que les noms de ces divinités ne pouvaient être qu'un jeu dont on n'avait rien à craindre. Si, d'un côté, la réligion des anciens, qui animait tout, ouvrait un vaste champ à l'imagination des beaux esprits, de l'autre, les principes en étaient trop absurdes pour qu'on appréhendât de voir ressusciter Jupiter et Pluton par quelque secte de novateurs; mais l'on craignait ou l'on paraissait craindre les coups qu'une raison aveugle pouvait porter au christianisme. Comment ne voyait-on pas qu'il n'avait point à redouter une attaque aussi faible! Envoyé du ciel aux hommes, la vénération si juste et si ancienne que les peuples lui témoignaient avait été garantie pour toujours par les promesses de Dieu même. D'ailleurs, quelque absurde qu'une religion puisse être (reproche que l'impiété seule peut faire à la nôtre), ce ne sont jamais les philosophes qui la détruisent. Lors même qu'ils enseignent la vérité, ils se contentent de la montrer, sans forcer personne à la connaître. Un tel pouvoir n'appartient qu'à l'Etre tout-puissant. Ce sont les hommes inspirés qui éclairent le peuple, et les enthousiastes qui l'égarent. Le frein qu'on est obligé de mettre à la licence de ces derniers ne doit point nuire à cette liberté si nécessaire à la vraie philosophie, et dont la religion peut tirer les plus grands avantages. Si le christianisme ajoute à la philosophie les lumières qui lui manquent, s'il n'appartient qu'à la grâce de soumettre les incrédules, c'est à la philosophie qu'il est réservé de les réduire au silence; et, pour assurer le triomphe de la foi, les théologiens dont nous parlons n'avaient qu'à faire usage des armes qu'on aurait voulu employer contre elle. Mais, parmi ces mêmes hommes, quelques-uns avaient un intérêt beaucoup plus réel de s'opposer à l'avancement de la philosophie. Faussement persuadés que la croyance des peuples est d'autant plus ferme qu'on l'exerce sur plus d'objets différents, ils ne se contentaient pas d'exiger pour nos mystères la soumission qu'ils méritent; ils cherchaient à ériger en dogmes leurs opinions particulières, et c'étaient ces opinions mêmes, bien plus que les dogmes, qu'ils voulaient mettre en sûreté. Par là, ils auraient porté à la religion le coup le plus terrible, si elle eût été l'ouvrage des hommes; car il était à craindre que, leurs opinions étant une fois reconnues pour fausses, le peuple, qui ne discerne rien, ne traitât de la même manière ces vérités avec lesquelles on avait voulu les confondre. D'autres théologiens de meilleure foi, mais aussi dangereux, se joignaient à ces premiers par d'autres motifs. Quoique la religion soit uniquement destinée à régler nos moeurs et notre foi, ils la croyaient faite pour nous éclairer aussi sur le système du monde, c'est-à-dire sur ces matières que le Tout-Puissant a expressément abandonnées à nos disputes. Ils ne faisaient pas réflexion que les livres sacrés et les ouvrages des Pères, faits pour montrer au peuple comme aux philosophes ce qu'il faut pratiquer et croire, ne devaient point, sur les questions indifférentes, parler un autre langage que le peuple. Cependant le despotisme théologique ou le préjugé l'emporta. Un tribunal devenu puissant dans le midi de l'Europe, dans les Indes, dans le Nouveau-Monde, mais que la foi n'ordonne point de croire, ni la charité d'approuver, ou plutôt que la religion réprouve, quoique occupé par ses ministres et dont la France n'a pu s'accoutumer encore à prononcer le nom sans effroi, condamna un célèbre astronome pour avoir soutenu le mouvement de la terre, et le déclara hérétique: à peu près comme le pape Zacharie avait condamné, quelques siècles auparavant, un évêque pour n'avoir pas pensé comme Saint Augustin sur les antipodes, et pour avoir deviné leurs existence six cents ans avant que Christophe Colomb les découvrît. C'est ainsi que l'abus de l'autorité spirituelle, réunie à la temporelle, forçait la raison au silence, et peu s'en fallut qu'on ne défendit au genre humain de penser.
Pendant que des adversaires peu instruits ou malintentionnés faisaient ouvertement la guerre à la philosophie, elle se réfugiait, pour ainsi dire, dans les ouvrages de quelques grands hommes qui, sans avoir l'ambition dangereuse d'arracher le bandeau des yeux de leurs contemporains, préparaient de loin, dans l'ombre et le silence, la lumière dont le monde devait être éclairé peu à peu et par degrés insensibles. A la tête de ces illustres personnages doit être placé l'immortel chancelier d'Angleterre François Bacon, dont les ouvrages si justement estimés, et plus estimés pourtant qu'ils ne sont connus, méritent encore plus notre lecture que nos éloges. A considérer les vues saines et étendues de ce grand homme, la multitude d'objets sur lesquels son esprit s'est porté, la hardiesse de son style, qui réunit partout les plus sublimes images avec la précision la plus rigoureuse, on serait tenté de le regarder comme le plus grand, le plus universel et le plus éloquent des philosophes. Bacon, né dans le sein de la nuit la plus profonde, sentit que la philosophie n'était pas encore, quoique bien des gens, sans doute, se flattassent d'y exceller; car, plus un siècle est grossier, plus il se croit instruit de tout ce qu'il peut savoir. Il commença donc par envisager d'une vue générale les divers objets de toutes les sciences naturelles; il partagea ces sciences en diflférentes branches, dont il fit l'énumération la plus exacte qu'il lui fut possible; il examina ce que l'on savait déjà sur chacun de ces objets, et fit le catalogue immense de ce qui restait à découvrir. C'est le but de son admirable ouvrage: De la dignité et de l'accroissement des connaissances humaines. Dans son Nouvel organe des sciences, il perfectionne les vues qu'il avait données dans le premier ouvrage; il les porte plus loin, et fait connaître la nécessité de la physique expérimentale, à laquelle on ne pensait point encore. Ennemi des systèmes, il n'envisage la philosophie que comme cette partie de nos connaissances qui doit contribuer à nous rendre meilleurs ou plus heureux: il semble la borner à la science des choses utiles, et recommande partout l'étude de la nature. Ses autres écrits sont formés sur le même plan; tout, jusqu'à leurs titres, y annonce l'homme de génie, l'esprit qui voit en grand. Il y recueille des faits, il y compare des expériences, il en indique un grand nombre à faire; il invite les savants à étudier et à perfectionner les arts, qu'il regarde comme la partie la plus relevée et la plus essentielle de la science humaine; il expose avec une simplicité noble ses conjectures et ses pensées sur les différents objets dignes d'intéresser les hommes, et il eût pu dire, comme ce vieillard de Térence, que rien de ce qui touche l'humanité ne lui était étranger. Science de la nature, morale, politique, économique, tout semble avoir été du ressort de cet esprit lumineux et profond; et on ne sait ce qu'on doit le plus admirer, ou des richesses qu'il répand sur tous les sujets qu'il traite, ou de la dignité avec laquelle il en parle. Ses écrits ne peuvent être mieux comparés qu'à ceux d'Hippocrate sur la médecine, et ils ne seraient ni moins admirés, ni moins lus, si la culture de l'esprit était aussi chère aux hommes que la conservation de la santé; mais il n'y a que les chefs de secte en tout genre dont les ouvrages puissent avoir un certain éclat. Bacon n'a pas été du nombre, et la forme de sa philosophie s'y opposait: elle était trop sage pour étonner personne. La scolastique qui dominait de son temps ne pouvait être renversée que par des opinions hardies et nouvelles, et il n'y a pas d'apparence qu'un philosophe qui se contente de dire aux hommes: "Voilà le peu que vous avez appris, voici ce qui vous reste à chercher", soit destiné à faire beaucoup de bruit parmi ses contemporains. Nous oserions même faire quelque reproche au chancelier Bacon d'avoir été peut-être trop timide, si nous ne savions avec quelle retenue, et pour ainsi dire avec quelle superstition on doit juger un génie si sublime. Quoiqu'il avoue que les scolastiques ont énervé les sciences par leurs questions minutieuses, et gue l'esprit doit sacrifier l'étude des êtres généraux à celle des objets particuliers, il semble pourtant, par l'emploi fréquent qu'il fait des termes de l'école, quelquefois même par celui des principes scolastiques, et par des divisions et subdivisions dont l'usage était alors fort à la mode, avoir marqué un peu trop de ménagement ou de déférence pour le goût dominant de son siècle. Ce grand homme, après avoir brisé tant de fers, était encore retenu par quelques chaînes qu'il ne pouvait ou n'osait rompre. Nous déclarons ici que nous devons principalement au chancelier Bacon l'arbre encyclopédique dont nous avons déjà parlé. Cependant nous n'avons pas cru devoir suivre de point en point le grand homme que nous reconnaissons ici pour notre maître. Si nous n'avons pas placé, comme lui, la raison après l'inagination, c'est que nous avons suivi, dans le système encyclopédique, l'ordre métaphysique des opérations de l'esprit, plutôt que l'ordre historique de ses progrès depuis la renaissance des lettres, ordre que l'illustre chancelier d'Angleterre avait peut-être en vue, jusqu'à un certain point, lorsqu'il faisait, comme il le dit, le cens et le dénombrement des connaissances humaines. D'ailleurs, le plan de Bacon étant différent du nôtre, et les sciences ayant fait depuis de grands progrès, on ne doit pas être surpris que nous ayons pris quelquefois une route différente.
|

|

| On peut considérer Descartes comme géomètre ou comme philosophe. Les mathématiques, dont il semble avoir fait assez peu de cas, font néanmoins aujourd'hui la partie la plus solide et la moins contestée de sa gloire. L'algèbre, créée en quelque manière par les Italiens, prodigieusement augmentée par notre illustre Viète, a reçu entre les mains de Descartes de nouveaux accroissements. Un des plus considérables est sa Methode des indéterminées, artifice très ingénieux et très subtil, qu'on a su appliquer depuis à un grand nombre de recherches. Mais ce qui a surtout immortalisé le nom de ce grand homme, c'est l'application qu'il a su faire de l'algèbre à la géométrie, idée plus vaste et des plus heureuses que l'esprit humain ait jamais eues, et qui sera toujours la clef des plus profondes recherches, non seulement dans la géométrie, mais dans toutes les sciences physicomathématiques. Comme philosophe, il a peut-être été aussi grand, mais il n'a pas été si heureux. La géométrie, qui, par la nature de son objet, doit toujours gagner sans perdre, ne pouvait manquer, étant maniée par un aussi grand génie, de faire des progrès très sensibles et apparents pour tout le monde. La philosophie se trouvait dans un état bien différent: tout y était à commencer; et que ne coûtent point les premiers pas en tout genre? Le mérite de les faire dispense de celui d'en faire de grands. Si Descartes, qui nous a ouvert la route, n'y a pas été aussi loin que ses sectateurs le croient, il s'en faut beaucoup que les sciences lui doivent aussi peu que le prétendent ses adversaires. Sa Méthode seule aurait suffi pour le rendre immortel; sa Dioptrique est la plus grande et la plus belle application qu'on eût faite encore de la géométrie à la physique; on voit enfin dans ses ouvrages, même les moins lus maintenant, briller partout le génie inventeur. Si on juge sans partialité ces tourbillons devenus aujourd'hui presque ridicules, on conviendra, j'ose le dire, qu'on ne pouvait alors imaginer rien de mieux. Les observations astronomiques qui ont servi à les détruire étaient encore imparfaites ou peu constatées: rien n'était plus naturel que de supposer un fluide qui transportât les planètes. Il n'y avait qu'une longue suite de phénomènes, de raisonnements et de calculs, et par conséquent une longue suite d'années, qui pût faire renoncer à une théorie si séduisante. Llle avait d'ailleurs l'avantage singulier de rendre raison de la gravitation des corps par la force centrifuge du tourbillon même, et je ne crains point d'avancer que cette explication de la pesanteur est une de plus belles et de plus ingénieuses hypothèses que la philosophie ait jamais imaginées. Newton, à qui la route avait été préparée par Huygens, parut enfin et donna à la philosophie une forme qu`elle semble devoir conserver. Ce grand génie vit qu'il était temps de bannir de la physique les conjectures et les hypothèses vagues, ou du moins de ne les donner que pour ce qu'elles valaient, et que cette science devait être uniquement soumise aux expériences et à la géométrie. C'est peut-être dans cette vue qu'il commença par inventer le calcul de l'infini et la méthode des suites dont les usages si étendus dans la géométrie même, le sont encore davantage pour déterminer les effets compliqués que l'on observe dans la nature, où tout semble s`exécuter par des espèces de progressions infinies. Les expériences de la pesanteur et les observations de Kepler firent découvrir au philosophe anglais la force qui retient les planètes dans leurs orbites. Il enseigna tout ensemble et à distinguer les causes de leurs mouvements et à les calculer avec une exactitude qu'on n'aurait pu exiger que du travail de plusieurs siècles. Créateur d'une optique toute nouvelle, il fit connaître la lumière aux hommes en la décomposant. Ce que nous pourrions ajouter à l'éloge de ce grand philosophe serait fort au-dessous du témoignage universel qu'on rend aujourd`hui à ses découvertes presque innom brables et à son génie tout à la fois étendu, juste et profond. En enrichissant la philosophie par une grande quantité de biens réels, il a mérité sans doute toute sa reconnaissance; mais il a peut-être plus fait pour elle en lui apprenant à être sage, et à contenir dans de justes bornes cette espèce d'audace que les circonstances avaient forcé Descartes à lui donner. Sa Théorie du Monde (car je ne veux pas dire son Système) est aujourd'hui si généralement reçue, qu'on commence à disputer à l'auteur l'honneur de l'invention, parce qu'on accuse d'abord les grands hommes de se tromper, et qu'on finit par les traiter de plagiaires. Je laisse à ceux qui trouvent tout dans les ouvrages des anciens le plaisir de découvrir dans ces ouvrages la gravitation des planètes, quand elle n'y serait pas. Mais en supposant même que les Grecs en aient eu l'idée, ce qui n'était chez eux qu'un système hasardé et romanesque est devenu une démonstration dans les mains de Newton: cette démonstration, qui n'appartient qu'à lui, fait le mérite réel de sa découverte; et l'attraction sans un tel appui serait une hypothèse comme tant d'autres. Si quelque écrivain célèbre s'avisait de prédire aujourd'hui sans aucune preuve qu'on parviendra un jour à faire de l'or, nos descendants auraient-ils droit, sous ce prétexte, de vouloir ôter la gloire du grand oeuvre à un chimiste qui en viendrait à bout? Et l'invention des lunettes en appartiendrait-elle moins à ses auteurs, quand même quelques anciens n'auraient pas cru impossible que nous étendissions un jour la sphère de notre vue? D'autres savants croient faire à Newton un reproche beaucoup plus fondé, en l'accusant d'avoir ramené dans la physique les qualités occultes des scolastiques et des anciens philosophes. Mais les savants dont nous parlons sont-ils bien sûrs que ces deux mots, vides de sens chez les scolastiques et destinés à marquer un être dont ils croyaient avoir l'idée, fussent autre chose chez les anciens philosophes que l'expression modeste de leur ignorance? Newton, qui avait étudié la nature, ne se flattait pas d'en savoir plus qu'eux sur la cause première qui produit les phénomènes; mais il n'employa pas le même langage, pour ne pas révolter des contemporains qui n'auraient pas manqué d'y attacher une autre idée que lui. Il se contenta de prouver que les tourbillons de Descartes ne pouvaient rendre raison du mouvement des planètes; que les phénomènes et les lois de la mécanique s'unissaient pour les renverser; qu'il y a une force par laquelle les planètes tendent les unes vers les autres, et dont le principe nous est entièrement inconnu. Il ne rejeta point l'impulsion; il se borna à demander qu'on s' en servît plus h eureusement q u' on n'avait fait jusqu'alors pour expliquer les mouvements des planètes: ses désirs n'ont point encore été remplis, et ne le seront peutêtre de longtemps. Après tout, quel mal aurait-il fait à la philosophie, en nous donnant lieu de penser que la matière peut avoir des propriétés que nous ne lui soupçonnions pas, et en nous désabusant de la confiance ridicule où nous sommes de les connaître toutes! A l'égard de la métaphysique, il paraît que Newton ne l'avait pas entièrement négligée. Il était trop grand philosophe pour ne pas sentir qu'elle est la base de nos connaissances, et qu'il faut chercher dans elle seule des notions nettes et exactes de tout: il paraît même, par les ouvrages de ce profond géomètre, qu'il était parvenu à se faire de telles notions sur les principaux objets qui l'avaient occupé. Cependant, soit qu'il fût peu content luimême des progrès qu'il avait faits dans la métaphysique, soit qu'il crût difficile de donner au genre humain des lumières bien satisfaisantes ou bien étendues sur une science trop souvent incertaine et contentieuse, soit enfin qu'il craignît qu'à l'ombre de son autorité on n'abusât de sa métaphysique comme on avait abusé de celle de Descartes pour soutenir des opinions dangereuses ou erronées, il s'abstint presque absolument d'en parler dans ceux de ses écrits qui sont les plus connus; et on ne peut guère apprendre ce qu'il pensait sur les différents objets de cette science, que dans les ouvrages de ses disciples. Ainsi, comme il n'a causé sur ce point aucune révolution, no us nous abstiendrons de le considérer de ce côté-là. Ce que Newton n'avait osé ou n'aurait peut-être pu faire, Locke l'entreprit et l'exécuta avec succès. On peut dire qu'il créa la métaphysique à peu près comme Newton avait créé la physique. Il concut que les abstractions et les questions ridicules qu'on avait jusqu'alors agitées, et qui avaient fait comme la substance de la philosophie, étaient la partie qu'il fallait surtout proscrire. Il chercha dans ses abstractions et dans les abus des signes les causes principales de nos erreurs, et les y trouva. Pour connaître notre âme, ses idées et ses affections, il n'étudia point les livres, parce qu'ils l'auraient mal instruit: il se contenta de descendre profondément en lui-même; et, après s'être, pour ainsi dire, contemplé longtemps, il ne fit dans son traité de l'Entendement humain que présenter aux hommes le miroir dans lequel il s'était vu. En un mot, il réduisit la métaphysique à ce qu'elle doit être en effet, la physique expérimentale de l'âme: espèce de physique très différente de celle des corps, non seulement par son objet, mais par la nianière de l'envisager. Dans celle-ci on peut découvrir, et on découvre souvent des phénomènes inconnus; dans l'autre, les faits aussi anciens que le monde existent également dans tous les hommes, tant pis pour qui croit en voir de nouveaux. La métaphysique raisonnable ne peut consister, comme la physique expérimentale, qu'à rassembler avec soin tous ces faits, à les réduire en un corps, à expliquer les uns par les autres, en distinguant ceux qui doivent tenir le premier rang et servir comme de base. Et un mot, les principes de la métaphysique, aussi simples que les axiom es, sont les mê mes pour les philosoph es et pour le peuple. Mais le peu de progrès que cette science a faits depuis longtemps montre combien il est rare d'appliquer heureusement ces principes, soit par la difficulté que renferme un pareil travail, soit peut-être aussi par l'impatience naturelle qui empêche de s'y borner. Cependant le titre de métaphysicien, et même de grand métaphysicien, est encore assez commun dans notre siècle; car nous aimons à tout prodiguer: mais qu'il y a peu de personnes véritablement dignes de ce nom! Combien y en a-t-il qui ne le méritent que par le malheureux talent d'obscurcir avec beaucoup de subtilité des idées claires, et de préférer, dans les notions qu'ils se forment, l'extraordinaire au vrai, qui est toujours simple? Il ne faut pas s'étonner après cela si la plupart de ceux qu'on appelle métaphysiciens font si peu de cas les uns des autres. Je ne doute point que ce titre ne soit bientôt une injure pour nos bons esprits, comme le nom de sophiste, qui pourtant signifie sage, avili en Grèce par ceux qui le portaient, fut rejeté par les vrais philosophes. Tels sont les principaux génies que l'esprit humain doit regarder comme ses maîtres, et à qui la Grèce eût élevé des statues, quand même elle eût été obligée, pour leur faire place, d'abattre celles de quelques conquérants.
Les bornes de ce discours préliminaire nous empêchent de parler de plusieurs philosophes illustres, qui, sans se proposer des vues aussi grandes que ceux dont nous venons de faire mention, n'ont pas laissé par leurs travaux de contribuer beaucoup à l'avancement des sciences, et ont pour ainsi dire levé un coin du voile qui nous cachait la vérité De ce nombre sont Galilée à qui la géographie doit tant pour ses découvertes astronomiques, et la mécanique pour sa théorie de l'accélération; Harvey, que la découverte de la circulation du sang rendra immortel; Huygens, que nous avons déjà nommé, et qui, par des ouvrages pleins de force et de génie, a si bien mérité de la géométrie et de la physique; Pascal, auteur d'un traité sur la cycloïde, qu'on doit regarder comme un prodige de sagacité et de pénétration, et d'un traité de l'équilibre des liqueurs et de la pesanteur de l'air qui nous a ouvert une science nouvelle: génie universel et sublime, dont les talents ne pourraient être trop regrettés par la philosophie, si la religion n'en avait pas profité; Malebranche qui a si bien démêlé les erreurs des sens, et qui a connu celles de l'imagination, comme s'il n'avait pas été souvent trompé par la sienne; Boyle, le père de la physique expérimentale; plusieurs autres enfin, parmi lesquels doivent être comptés avec distinction les Vesale, les Sydenham, les Boerhaave, et une infinité d'anatomistes et de physiciens célèbres.
|

|

| Nous finirons par une observation qui ne paraîtra, pas surprenante à des philosophes. Ce n'est guère de leur vivant que les grands hommes dont nous venons de parler ont changé la face des sciences. Nous avons déjà vu pourquoi Bacon n'a point été chef de secte; deux raisons se joignent à celle que nous en avons, apportée. Ce grand philosophe a écrit plusieurs de ses ouvrages dans une retraite à laquelle ses ennemis l'avaient forcé, et le mal qu'ils avaient fait à l'homme d'État n'a pu manquer de nuire à l'auteur. D'ailleurs, uniquement occupé d'être utile, il a peut-être embrassé trop de matières, pour que ses contemporains dussent se laisser éclairer à la fois sur un si grand nombre d'objets. On ne permet guère aux grands génies d'en savoir tant; on veut bien apprendre quelque chose d'eux sur un sujet borné, mais on ne veut pas être obligé à réformer toutes ses idées sur les leurs. C'est en partie pour cette raison que les ouvrages de Descartes ont essuyé en France après sa mort plus de persécution que leur auteur n'en avait souffert en Hollande pendant sa vie; ce n'a été qu'avec beaucoup de peine que les écoles ont enfin osé admettre une physique qu'elles s'imaginaient être contraire à celle de Moïse. Newton, il est vrai, a trouvé dans ses contemporains moins de contradiction; soit que les découvertes géométriques par lesquelles il s'annonça et dont on ne pouvait lui disputer ni la propriété, ni la réalité, eussent accoutumé à l'admiration pour lui, et à lui rendre des hommages qui n'étaient ni trop subits ni trop forcés; soit que, par sa supériorité, il imposât silence à l'envie, soit enfin, ce qui paraît plus difficile à croire, qu'il eût affaire à une nation moins injuste que les autres. Il a eu l'avantage singulier de voir sa philosophie généralement reçue en Angleterre de son vivant, et d'avoir tous ses compatriotes pour partisans et pour admirateurs. Cependant il s'en fallait bien que le reste de l'Europe fît alors le même accueil à ses ouvrages. Non seulement ils étaient inconnus en France, mais la philosophie scolastique y dominait encore, lorsque Newton avait déjà renversé la physique cartésienne; et les tourbillons étaient détruits avant que nous songeassions à les adopter. Nous avons été aussi longtemps à les soutenir qu'à les recevoir. Il ne faut qu'ouvrir nos livres, pour voir avec surprise qu'il n'y a pas encore trente ans qu'on a commencé en France à renoncer au cartésianisme. Le premier qui ait osé parmi nous se déclarer ouvertement newtonien, est l'auteur du Discours sur la figure des astres, qui joint à des connaissances géométriques très étendues cet esprit philosophique avec lequel elles ne se trouvent pas toujours, et ce talent d'écrire auquel on ne croira plus qu'elles nuisent, quand on aura lu ses ouvrages Maupertuis a cru qu'on pouvait être bon citoyen sans adopter aveuglément la physique de son pays, et pour attaquer cette physique, il a eu besoin d'un courage dont on doit, lui savoir gré. En effet, notre nation, singulièrement avide de nouveautés dans les matières de goût, est, en matière de science, très attachée aux opinions anciennes. Deux dispositions si contraires en apparence ont leurs principes dans plusieurs causes, et surtout dans cette ardeur de jouir, qui semble constituer notre caractère. Tout ce qui est du ressort du sentiment n'est pas fait pour être longtemps cherché, et cesse d'être agréable dès qu'il ne se présente pas tout d'un coup; mais aussi l'ardeur avec laquelle nous nous y, livrons s'épuise bientôt, et l'âme, dégoûtée aussitôt que remplie, vole vers un nouvel objet qu'elle abandonnera de même. Au contraire, ce n'est qu'à force de méditation que l'esprit parvient à ce qu'il cherche, mais, par cette raison, il veut jouir aussi longtemps qu'il a cherché, surtout lorsqu'il ne s'agit que d'une philosophie hypothétique et conjecturale, beaucoup plus riante que des calculs et des combinaisons exactes. Les physiciens attachés à leurs théories, avec le même zèle et par les mêmes motifs, que les artisans à leurs, pratiques, ont, sur ce point, beaucoup plus de ressemblance avec le peuple qu'ils ne s'imaginent. Respectons toujours Descartes; mais abandonnons sans peine des opinions qu'il eût combattues luimême un siècle plus tard. Surtout ne confondons point sa cause avec celle de ses sectateurs. Le génie qu'il a montré en cherchant dans la nuit la plus sombre une route nouvelle, quoique trompeuse, n'était qu'à lui: ceux qui l'ont osé suivre les premiers dans les ténèbres ont au moins marqué du courage; mais il n'y a plus de gloire à s'égarer sur ses traces depuis que la lumière est venue. Parmi le peu de savants qui défendent encore sa doctrine, il eût désavoué lui-même ceux qui n'y tiennent que par un attachement servile à ce qu'ils ont appris dans leur enfance, ou par je ne sais quel préjugé national, la honte de la philosophie. Avec de tels motifs, on peut être le dernier de ses partisans; mais on n'aurait pas eu le mérite d'être son premier disciple ou plutôt on eût été son adversaire lorsqu'il n'y avait que de l'injustice à l'être. Pour avoir le droit d'admirer les erreurs d'un grand homme, il faut savoir les reconnaître, quand le temps les a mises au grand jour. Aussi les jeunes gens qu'on regarde d'ordinaire comme d'assez mauvais juges, sont peut-être les meilleurs dans les matières philosophiques et dans beaucoup d'autres, lorsqu'ils ne sont pas dépourvus de lumière; parce que, tout leur étant également nouveau, ils n'ont d'autre intérêt que celui de bien choisir. Il en a été de Locke à peu près comme de Bacon, de Descartes et de Newton. Oublié longtemps pour Rohault et pour Régis et encore assez peu connu de la multitude, il commence enfin à avoir parmi nous des lecteurs et quelques partisans. C'est ainsi que les personnages illustres, souvent trop au-dessus de leur siècle, travaillent presque toujours en pure perte pour leur siècle même; c'est aux âges suivants qu'il est réservé de recueillir le fruit de leurs lumières. Aussi les restaurateurs des sciences ne jouissent-ils presque jamais de toute la gloire qu'ils méritent; des esprits fort intérieurs la leur arrachent parce que les grands hommes se livrent à leur génie, et les hommes médiocres à celui de leur nation. Il est vrai que le témoignage que la supériorité ne peut s'empêcher de se rendre à elle-même, suffit pour la dédommager des suffrages vulgaires: elle se nourrit de sa propre sub-, stance, et cette réputation, dont on est si avide, ne sert souvent qu`à consoler la médiocrité des avantages que le talent a-sur elle. On peut dire en effet que la renommée, qui publie tout, raconte plus souvent ce qu'elle voit, et que les poètes, qui lui ont donné cent bouches, devaient bien aussi lui donner un bandeau.
La philosophie, qui forme le goût dominant de notre siècle, semble, par les progrès qu'elle fait parmi nous, vouloir réparer le temps qu'elle a perdu, et se venger de l'espèce de mépris que lui avaient marqué nos pères. Ce mépris est aujourd'hui retombé sur l'érudition, et n'en est pas plus juste pour avoir changé d'objet. On s'imagine que nous avons tiré des ouvrages des anciens tout ce qu'il nous importait de savoir, et sur ce fondement on dispenserait volontiers de leur peine ceux qui vont encore les consulter. Il semble qu'on regarde l'antiquité comme un oracle qui a tout dit, et qu'il est inutile d'interroger; et on ne fait guère plus de cas aujourd'hui de la restitution d'un passage que de la découverte d'un petit rameau de veine dans le corps humain. Mais comme il serait ridicule de croire qu'il n'y a plus rien à découvrir dans l'anatomie, parce que les anatomistes se livrent quelquefois à des recherches inutiles en apparence, et souvent utiles par leurs suites, il ne serait pas moins absurde de vouloir interdire l'érudition, sous prétexte des recherches peu importantes auxquelles IIOS savants peuvent s'abandonner. C'est être ignorant ou présomptueux de croire q ue tout so it vu dans quelque matière que ce puisse être, et que nous n'ayons plus aucun avantage à tirer de l'étude et de la lecture des anciens. L'usage de tout écrire aujourd'hui en langue vugaire, a contribué sans doute à fortifier ce préjugé, et peut-être est plus pernicieux que le préjugé même. Notre langue s'étant répandue par toute l'Europe, nous avons cru qu'il était temps de la substituer à la langue latine, qui, depuis la renaissance des lettres, était celle de nos savants. J'avoue qu'un philosophe est beaucoup plus excusable d'écrire en francais, qu'un Francais de faire des vers latins; je veux bien même convenir que cet usage a contribué à rendre la lumière plus générale, si néanmoins c'est étendre réellement l'esprit d'un peuple, que d'en étendre la superficie. Cependant il résulte de là un inconvénient que nous aurions dû prévoir. Les savants des autres nations, à qui nous avons donné l'exemple, ont cru avec raison qu'ils écriraient encore mieux dans leur langue que dans la nôtre. L'Angleterre nous a donc imités; l'Allemagne où le latin semblait s'être réfugié, commence insensiblement à en perdre l'usage; je ne doute pas qu'elle ne soit bientôt suivie par les Suédois, les Danois et les Russes. Ainsi, avant la fin du dix-huitième siècle, un philosophe qui voudra s'instruire à fond des découvertes de ses prédécesseurs, sera contraint de charger sa mémoire de sept à huit langues différentes, et, après avoir consumé à les apprendre le temps le plus précieux de sa vie, il mourra avant de commencer à s'instruire. L'usage de la langue latine, dont nous avons fait voir le ridicule dans les matières de goût, ne pourrait être que très utile dans les ouvrages de philosophie dont la clarté et la précision doivent faire tout le mérite et qui n'ont besoin que d'une langue universelle et de convention. Il serait donc à souhaiter qu'on rétablît cet usage; mais il n'y a pas lieu de l'espérer. L'abus dont nous osons nous plaindre est trop favorable à la vanité et à la paresse, pour qu'on se flatte de le déraciner. Les philosophes, comme, les autres écrivains, veulent être lus, et surtout de leur nation. S'ils se servaient d'une langue moins familière, ils auraient moins de bouches pour les célébrer, et on ne pourrait se vanter de les entendre. Il est vrai qu'avec moins d'admirateurs ils auraient de meilleurs juges, mais c'est un avantage qui touche peu, parce que la réputation tient plus au nombre qu'au mérite de ceux qui la distribuent. En récompense, car il ne faut rien outrer, nos livres de science semblent avoir acquis jusqu'à l'espèce d'avantage qui semblait devoir être particulier aux ouvrages de belles-lettres. Un écrivain respectable, que notre siècle a eu le bonheur de posséder longtemps, et dont je louerais ici les différentes productions si je ne me bornais pas à l'envisager comme philo sophe, a appris aux savants à secouer le joug du pédantisme. Supérieur dans l'art de mettre en leur jour les idées les plus abstraites, il a su, par beaucoup de méthode, de précision et de clarté, les abaisser à la portée des esprits qu'on aurait cru les moins faits pour; les saisir. Il a même osé prêter à la philosophie les ornements qui semblaient lui être les plus étrangers, et qu'elle paraissait devoir s'interdire le plus sévèrement; et cette hardiesse a été justifiée par le succès le plus général et le plus flatteur. Mais, semblable à tous les écrivains originaux, il a laissé bien loin derrière lui ceux qui ont cru pouvoir l'imiter. L'auteur de l'Histoire naturelle a suivi une route différente Rival de Platon et de Lucrèce il a répandu dans son ouvrage, dont la réputation croît de jour en jour, cette noblesse et cette élévation de style qui sont si propres aux matières philosophiques, et qui dans les écrits du sage doivent être la peinture de son âme. Cependant la philosophie, en songeant à plaire, parait n'avoir pas oublié qu'elle est principalement faite pour instruire; c'est par cette raison que le goût des systèm es, plus propre à flatter l 'imagination qu' à éclairer la raison est aujourd'hui presque absolument banni des bons ouvrages. Un de nos meilleurs philosophes, l'abbé de Condillac, semble lui avoir porté les derniers coups. L' esprit d 'hypothèse et de conjecture pouvait être autrefois fort utile, et avait même été nécessaire pour la renaissance de la philosophie, parce qu'alors il s'agissait encore moins de bien penser que d'apprendre à penser par soimême. Mais les temps sont changés, et un écrivain qui ferait parmi nous l'éloge des systèmes viendrait trop tard. Les avantages que cet esprit peut procurer maintenant sont en trop petit nombre pour balancer les inconvénients qui en résultent; et si on prétend prouver l'utilité des systèmes par un très petit nombre de découvertes qu'ils ont occasionnées autrefois, on pourrait de même conseiller à nos géomètres de s'appliquer à la quadrature du cercle, parce que les efforts de plusieurs mathématiciens, pour la trouver, nous ont produit quelques théorèmes. L'esprit de système est dans la physique ce que la métaphysique est dans la géometrie. S'il est quelquefois nécessaire pour nous mettre dans le chemin de la vérité, il est presque toujours incapable de nous y conduire par lui-même. Eclairé par l'observation de la nature, il peut entrevoir les causes des phénomènes; mais c'est au calcul à assurer, pour ainsi dire, l'existence de ces causes, en déterminant exactement les effets qu'elles peuvent produire, et en comparant ces effets avec ceux que l'expérience nous découvre. Toute hypothèse, dénuée d'un tel secours, acquiert rarement ce degré de certitude qu'on doit toujours chercher dans les sciences naturelles, et qui néanmoins se trouve si peu dans ces conjectures frivoles qu'on honore du . nom de systèmes. S'il ne pouvait y en avoir que de cette espèce, le principal mérite du physicien serait a proprement parler, d'avoir l'esprit de système et de n'en faire jamais. A l'égard de l'usage dans les autres sciences, mille expériences prouvent combien il est dangereux. La physique est donc uniquement bornée aux observations et aux calculs; la médecine à l'histoire du corps humain, de ses maladies et de leurs remèdes; l'histoire naturelle à la description détaillée des végétaux, des animaux et des minéraux; la chimie à la composition et à la décomposition expérimentale des corps; en un mot, toutes les sciences renfermées dans les faits, autant qu'il est possible, et dans les conséquences qu'on en peut déduire, n'accordent rien à l'opinion que quand elles y sont forcées. Je ne parle point de la géométrie, de l'astronomie et de la mécanique, destinées par leur nature à aller toujours en se perfectionnant de plus en plus.
On abuse des meilleures choses. Cet esprit philosophique, si à la mode aujourd'hui, qui veut tout voir et ne rien supposer, s'est répandu jusque dans les belleslettres; on prétend même qu'il est nuisible à leurs progrès, et il est difficile de se le dissimuler. Notre siècle, porté à la combinaison et à l'analyse, semble vouloir introduire les discussions froides et didactiques dans les choses de sentiment. Ce n'est pas que les passions et le goût n'aient une logique qui leur appartient, mais cette logique a des principes tout différents de ceux de la logique ordinaire: ce sont ces principes qu'il faut démêler en nous; et c'est, il faut l'avouer, de quoi une philosophie commune est peu capable. Livrée tout entière à l' exam en des perceptions tranquilles de l'âme, il lui est bien plus facile d'en démêler les nuances que celles de nos passions, ou en général des sentiments vifs qui nous affectent. Et comment cette espèce de sentiments ne serait-elle pas difficile à analyser avec justesse? Si, d'un côté, il faut se livrer à eux pour les connaître, de l'autre, le temps où l'âme en est affectée est celui où elle peut les étudier le moins. Il faut pourtant convenir que cet esprit de discussion a contribué à affranchir notre littérature de l'admiration aveugle des anciens; il nous a appris à n'estimer en eux que les beautés que nous serions contraints d'admirer dans des modernes. Mais c'est peut-être aussi à la même source que nous devons je ne sais quelle métaphysique du coeur, qui s'est emparée de nos théâtres; s 'il n e fallait pas l' en bannir entièrement, en core moins fallait-il l'y laisser régner. Cette anatomie de l'âme s'est glissée jusque dans nos conversations; on y disserte, on n'y parle plus; et nos sociétés ont perdu leurs principaux agréments, la chaleut et la gaieté. Ne soyons donc pas étonnés que nos ouvrages d'esprit soient en général inférieurs à ceux du siècle précédent. On peut même en trouver la raison dans les efforts que nous faisons pour surpasser nos prédécesseurs. Le goût et l'art d'écrire font en peu de temps des progrès rapides, dès qu'une fois la véritable route est ouverte: à peine un grand génie at-il entrevu le beau, qu'il l'aperçoit dans toute son étendue, et l'imitation de la belle nature semble bornée à certaines limites qu'une génération ou deux tout au plus ont bientôt atteintes; il ne reste à la génération suivante que d'imiter; mais elle ne se contente pas de ce partage; les richesses qu'elle a acquises, autorisent le désir de les accroître; elle veut ajouter à ce qu'elle a reçu, et manque le but en cherchant à le passer. On a donc tout à la fois plus de principes pour bien juger, un plus grand fonds de lumières, plus de bons juges, et moins de bons ouvrages; on ne dit point d'un livre qu'il est bon, mais que c'est le livre d'un homme d'esprit. C'est ainsi que le siècle de Démétrius de Phalère a succédé immédiatement à celui de Démosthène, le siècle de Lucain et de Sénèque à celui de Cicéron et de Virgile, et le nôtre à celui de Louis XIV. Je ne parle ici que du siècle en général, car je suis bien éloigné de faire la satire de quelques hommes d'un mérite rare avec qui nous vivons. La constitution physique du monde littéraire entraîne, comme celle du monde matériel, des révolutions forcées dont il serait aussi injuste de se plaindre que du changement des saisons. D'ailleurs, comme nous devons au siècle de Pline les ouvrages admirables de Quintilien et de Tacite, que la génération précédente n'aurait peut- être pas été en état de produire, le nôtre laissera à la postérité des monuments dont il a droit de se glorifier. Un poète célèbre par ses talents et par ses malheurs a effacé Malherbe dans ses odes, et Marot dans ses épigrammes et dans ses épîtres. Nous avons vu naître le seul poème épique que la France puisse opposer à ceux des Grecs, des Romains, des Italiens, des Anglais et des Espagnols. Deux hommes illustres, entre lesquels notre nation semble partagée, et que la postérité saura mettre chacun à sa place, se disputent la gloire du cothurne, et l'on voit encore avec un extrème plaisir leurs tragédies après celles de Corneille et de Racine. L'un de ces deux hommes, le même à qui nous devons la Henriade, sûr d'obtenir parmi le très petit nombre de grands poètes une place distinguée, et qui n'est qu'à lui, possède en même temps au plus haut degré un talent que n'a eu presque aucun poète, même dans un degré médiocre: celui d'écrire en prose. Personne n'a mieux connu l'art si rare de rendre sans effort chaque idée par le terme qui lui est propre, d'embellir tout sans se méprendre sur le coloris propre à chaque chose; enfin (ce qui caractérise plus qu'on ne pense les grands écrivains), de n'être jam a is ni au-dessus ni au-dessous de son sujet. Son Essai sur le siècle de Louis XIV est un morceau d'autant plus précieux que l'auteur n'avait en ce genre aucun modèle, ni parmi les anciens, ni parmi nous; son Histoire de Charles XII, par la rapidité et la noblesse du style, est digne du héros qu'il avait à peindre; ses pièces fugitives, supérieures à toutes celles que nous estimons le plus, suffiraient, par leur nombre et par leur mérite, pour immortaliser plusieurs écrivains. Que ne puis-je, en parcourant ici ses nombreux et admirables ouvrages, payer à ce génie rare le tribut d'éloges qu'il mérite, qu'il a reçu tant de fois de ses compatriotes, des étrangers et de ses ennemis, et auquel la postérité mettra le comble quand il ne pourra plus en jouir! Ce ne sont pas là nos seules richesses. Un écrivain judicieux, aussi bon citoyen que grand philosophe, nous a donné sur les priocipes des lois un ouvrage dé-crié par quelques Français, applaudi par la nation et admiré de toute l'Europe, ouvrage qui sera un monument immortel du génie et de la vertu de son auteur, et des progrès de la raison dans un siècle dont le milieu sera une époque mémorable dans l'histoire de la philosophie. D'excellents auteurs ont écrit l'histoire ancienne et moderne; des esprits justes et éclairés l'ont approfondie. La comédie a acquis un nouveau genre qu'on aurait tort de rejeter, puisqu'il en résulte un plaisir de plus, et que d'ailleurs ce genre même n'a pas été aussi inconnu des anciens qu'on voudrait nous le persuader. Enfin, nous avons plusieurs romans qui nous empêchent de regretter ceux du dernier siècle. Les beaux-arts ne sont pas moins en honneur dans notre nation. Si j'en crois les amateurs éclairés, notre, école de peinture est la première de l'Europe, et plusieurs ouvrages de nos sculpteurs n'auraient pas été désavoués par les anciens. La musique est peutêtre, de tous ces arts, celui qui a fait, depuis quinze ans, le plus de progrès parmi nous. Grâce aux travaux d'un génie mâle, hardi et fécond, les étrangers, qui ne pouvaient souffrir nos symphonies, commencent à les goûter, et les Français paraissent enfin persuadés que Lully avait laissé dans ce genre beaucoup à faire. Rameau, en poussant la pratique de son art à un si haut degré de perfection, est devenue tout ensemble le modèle et l'objet de la jalousie d'un grand nombre d'artistes qui le décrient en s'efforçant de l'imiter; mais, ce qui le distingue plus particulièrement, c'est d'avoir réfléchi avec beaucoup de succès sur la théorie de ce même art, d'avoir su trouver dans la base fondamentale le principe de l'harmonie et de la mé]odie; d'avoir réduit, par ce moyen, à des lois plus certaines et plus simples, une science livrèe avant lui à des règles arbitraires ou dictées par une expérience aveugle. Je saisis avec empressement l'occasion de célébrer cet artiste philosophe dans un discours destiné principalement à l'éloge des grands hommes. Son mérite, dont il a forcé notre siècle à convenir, ne sera bien connu que quand le temps aura fait taire l'envie; et son nom, cher à la partie de notre nation la plus éclairée, ne peut blesser ici personne; mais, dût il déplaire à quelques prétendus Mécènes, un philosophe serait bien à plaindre si, même en matière de sciences et de goût, il ne se permettait pas de dire la vérité. Voilà les biens que nous possédons. Quelle idée ne se fprmera-t-on pas de nos trésors littéraires, si l'on joint aux ouvrages de tant de grands hommes les travaux de toutes les compagnies savantes destinées à maintenir le goût des sciences et des lettres, et à qui nous devons tant d'excellents livres! De pareilles sociétés ne peuvent manquer de produire dans un État de grands avantages, pourvu qu'en les multipliant à l'excès on n'en facilite point l'entrée à un trop grand nombre de gens médiocres; qu'on en bannisse toute inégalité propre à éloigner ou à rebuter des hommes faits pour éclairer les autres; qu'on n'y connaisse d'autre supériorité que celle du génie; que la considération y soit le prix du travail; enfin, que les récompenses y viennent chercher les talents, et ne leur soient point enlevées par l'intrigue; car, il ne faut pas s'y tromper, on nuit plus au progrès de l'esprit en plaçant mal les récompenses qu'en les supprimant. Avouons même, à l'honneur des lettres, que les savants n'ont pas toujours besoin d'être récompensés pour se multiplier: témoin l'Angleterre, à qui les sciences doivent tant, sans que le gouvernement fasse rien pour elles. Il est vrai que la nation les considère, qu'elle les respecte même; et cette espèce de récompense, supérieure à toutes les autres, est sans doute le moyen le plus sûr de faire fleurir les sciences et les arts, pa rce que c' est le gouvernement qui donne les places, et le public qui distribue l'estime. L'amour des lettres, qui est un mérite chez nos voisins, n'est encore, à la vérité, qu'une mode parmi nous, et ne sera peut-être jamais autre chose; mais, quelque dangereuse que soit cette mode, qui, pour un Mécène éclairé, produit cent amateurs ignorants et orgueilleux, peut-être lui sommes-nous redevables de n'être pas encore tombés dans la barbarie, où une foule de circonstances tendent à nous précipiter. On peut regarder comme une des principales cet amour du faux bel esprit qui protège l'ignorance, qui s'en fait honneur; et qui la répandra universellement tôt ou tard. Elle sera le fruit et le terme du mauvais goût; j'ajoute qu'elle en sera le remède, car tout a des révolutions réglées, et l'obscurité se terminera par un nouveau siècle de lumière. Nous serons plus frappés du grand jour après avoir été quelque temps dans les ténèbres. Elles seront comme une espèce d'anarchie très funeste par elle-même, mais quelquefois utile par ses suites. Gardons-nous pourtant de souhaiter une révolution si redoutable. La barbarie dure des siècles: il semble que ce soit notre élément; la raison et le bon goût ne font que passer.1
Voilà ce que nous avions à dire sur cette collection immense. Elle se présente avec tout ce qui peut intéresser pour elle; I'impatience que l'on a témoignée de la voir paraître, les obstacles qui en ont retardé la publication, les circonstances qui nous ont forcés à nous en charger; le zèle avec lequel nous nous sommes livrés à ce travail comme s'il eût été de notre choix; les éloges que les bons citoyens ont donnés à l'entreprise; les se cours in nombrab les et de toute esp èce que nous avons reçus; la protection du gouvernement, des ennemis tant faibles que puissants, qui ont cherché, quoiqu'en vain, à étouffer l'ouvrage avant sa naissance; enfin, des auteurs sans cabale et sans intrigue, qui n'attendent d'autre récompense de leurs soins et de leurs efforts, que la satisfaction d'avoir bien mérité de leur patrie. Nous ne chercherons point à comparer ce dictionnaire aux autres; nous reconnaissons avec plaisir qu'ils nous ont tous été utiles, et notre travail ne consiste point à décrier celui de personne. C'est au public qui lit à nous juger; nous croyons devoir le distinguer de celui qui parle.
Anmerkung:
|

About d'Alembert (ENG)., Om d'Alembert (SWE)
Note: Paragraphs in bold face are not formatted in that way in the source text. This is done here only, for editorial and design purposes. /The Art Bin editor