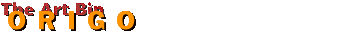

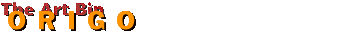 |
|
 | |

| Discours Préliminaire de l'Encyclopédie |
| Jean Le Rond d'Alembert, 1751 (edition Wieleitner, 1911) |

| Première Partie.
L'Encyclopédie que nous présentons au public est, comme son titre l'annonce, I'ouvrage d'une société de gens de lettres. Nous croirions pouvoir assurer, si nous n'étions pas du nombre, qu'ils sont tous avantageusement connus ou dignes de l'être. Mais sans vouloir prévenir un jugement qu'il n'appartient qu'aux savants de porter, il est au moins de notre devoir d'écarter avant toutes choses l'objection la plus capable de nuire au succès d'une si grande entreprise. Nous déclarons donc que nous n'avons point eu la témérité de nous charger seuls d'un poids si supérieur à nos forces, et que notre fonction d'éditeurs consiste principalement à mettre en ordre des matériaux dont la partie la plus considérable nous a été entièrement fournie. Nous avions fait expressément la même déclaration dans le corps du prospectus;1 mais elle aurait peut-être dû se trouver à la tête. Par cette précaution, nous eussions apparemment répondu d'avance à une foule de gens du monde, et même à quelques gens de lettres, qui nous ont demandé comment deux personnes pouvaient traiter de toutes les sciences et de tous les arts, et qui néanmoins avaient jeté sans doute les yeux sur le prospectus, puisqu'ils ont bien voulu l'honorer de leurs éloges. Ainsi, le seul moyen d'empêcher sans retour leur objection de reparaître, c'est d'employer, comme nous faisons ici, les premières lignes de notre ouvrage à la détruire. Ce début est donc uniquement destiné à ceux de nos lecteurs qui ne jugeront pas à propos d'aller plus loin: nous devons aux autres un détail beaucoup plus étendu sur l'exécution de l'Encyclopédie; mais ce détail, si important par sa nature et par sa matière, demande à être précédé de quelques réflexions philosophiques.
L'ouvrage que nous commençons (et que nous désirons de finir) a deux objets: comme encyclopédie, il doit exposer, autant que possible, l'ordre et l'enchaînementdes connaissances humaines; comme dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, il doit contenir, sur chaque science et sur chaque art, soit libéral, soit mécanique, des principes généraux qui en sont la base, et les détails les plus essentiels qui en font le corps et la substance. Ces deux points de vue, d'encyclopédie et de dictionnaire raisonné, formeront donc le plan et la division du discours préliminaire. Nous allons les envisager, les suivre l'un après l'autre, et rendre compte des moyens par lesquels on a tâché de satisfaire à ce double objet.
Pour peu qu'on ait réfléchi sur la liaison que les découvertes ont entre elles, il est facile de s'apercevoir que les sciences et les arts se prêtent mutuellement des secours, et qu'il y a par conséquent une chaine qui les unit. Mais il est souvent difficile de réduire à un petit nombre de règles ou de notions générales chaque science ou chaque art en particulier; il ne l'est pas moins de renfermer, dans un système qui soit un, les branches infiniment variées de la science humaine.
Le premier pas que nous ayons a faire dans cette recherche est d'examiner, qu'on nous permette ce terme, la généalogie et la filiation de nos connaissances, les causes qui ont dû les faire naître et les caractères qui les distinguent; en un mot, de remonter jusqu'à l'origine et à la génération de nos idées. Indépendamment des secours que nous tirerons de cet examen pour l'énumération encyclopédique des sciences et des arts, il ne saurait être déplacé à la tête d'un dictionnaire raisonné des connaissances humaines.
|

|

| Toutes nos connaissances directes se réduisent à celles que nous recevons par les sens; d'où il s'ensuit que c'est à nos sensations que nous devons toutes nos idées. Ce principe des premiers philosophes a été longtemps regardé comme un axiome par les scolastiques; pour qu'ils lui fissent cet honneur, il suffisait qu'il fût ancien, et ils auraient défendu avec la même chaleur les formes substantielles ou les qualités occultes." Aussi, cette vérité fut-elle traitée, à la renaissance de la philosophie, comme les opinions absurdes, dont on aurait dû la distinguer; on la proscrivit avec ces opinions parce que rien n'est si dangereux pour le vrai et ne l'expose tant à être méconnu que l'alliage ou le voisinage de l'erreur. Le système des idées innèes, séduisant à plusieurs égards, et plus frappant peut-être parce qu'il était moins connu, a succédé à l'axionne des scolastiques; et, après avoir longtemps régné, il conserve encore quelques partisans: tant la vérité a de peine à reprendre sa place quand les préjugés ou le sophisme l'en ont chassée. Enfin, depuis assez peu de temps, on convient presque généralement que les anciens avaient raison, et ce n'est pas la seule question sur laquèlle nous commencons à nous rapprocher d'eux.
|

| Rien n'e st plus in contestable que l'existence de nos sensations; ainsi, pour prouver qu'elles sont le principe de toutes nos connaissances, il suffit de démontrer qu'elles peuvent l'être: car, en bonne philosophie, toute déduction qui a pour base des faits ou des vérités reconnues, est préférable à ce qui n'est appuyé que sur des hypothèses, même ingénieuses. Pourquoi supposer que nous ayons d'avance des notions purement intellectuelles, si nous n'avons besoin, pour les former, que de réfléchir sur nos sensations? Le détail où nous allons entrer fera voir que ces notions 'ont point, en effet, d'autre origine. La première chose que nos sensations nous apprennent et qui même n'en est pas distinguée, c'est notre existence, d'où il s'ensuit que nos premières idées réfléchies doivent tomber sur nous, c'est-à-dire sur ce, principe pensant qui constitue notre nature, et qui n'est point différent de nous- m êm es . La se conde connaissance que nous devons à nos sensations est l'existence des objets extérieurs, parmi lesquels notre propre corps doit être compris, puisqu'il nous est, pour ainsi dire, extérieur, même avant que nous ayons démêlé la nature du principe qui pense en nous. Ces objets innombrables produlent en nousmêmes, nous sommes forcés d'en sortiisent sur nous un effet si puissant, si continu, et qui nous unit tellement à eux, qu'après un premier instant où nos idées réfléchies nous rappellent en nous-mêmes, nous sommes forcès d'en sortir par les sensations qui nous assiègent de toutes parts, et qui nous arrachent à la solitude où nous resterions, sans elles. La multiplicité de ces sensations, I'accord que nous remarquons dans leur témoignage, les nuances que nous y observons, les affections involontaires qu'elles nous font éprouver, comparées avec la détermination volontaire, qui préside à nos idées réfléchies, et qui n'opère que sur nos sensations même: tout cela forme en nous un penchant insurmontable à assurer l'existence des objets auxquels nous rapportons ces sensations, et qui nous paraissent en être la cause; penchant que bien des philosophes ont regardé comme l'ouvrage d'un être supérieur et comme l'argument le plus convaincant de l'existence de ces objets. En effet, n'y ayant aucun rapport entre chaque sensation et l'objet qui l'occasionne, ou du moins auquel nous le rapportons, il ne paraît pas qu'on puisse trouver, par le raisonnement, de passage possible de l'un à l'autre: il n'y a qu'une espèce d'instinct, plus sûre que la raison même, qui puisse nous forcer à franchir un si grand intervalle; et cet instinct est si vif en nous, que quand on supposerait pour un moment qu'il subsistât pendant que les objets extérieurs seraient anéantis, ces mêmes objets, reproduits ïout à coup, ne pourraient augmenter sa force. Jugeons donc, sans balancer, que nos sensations, ont, en effet, hors de nous la cause que nous leur supposons, puisque le fait qui peut résulter de l'existence réelle de cette cause ne saurait différer en aucune manière de celui que nous éprouvons. Et n'imitons point ces philosophes dont parle Montaigne, qui, interrogés sur le principe des actions humaines, cherchent encore s'il y a des hommes. Loin de vouloir répandre des nuages sur une vérité reconnue des sceptiques, même lorsqu'ils ne disputent pas, laissons aux métaphysiciens éclairés le soin d'en développer le principe: c'est à eux àdéterminer, s'il est possible, quelle gradation observe notre âme dans ce premier pas qu'elle fait hors d'elle même, poussée, pour ainsi dire, et retenue tout à la fois par une foule de perceptions, qui, d'un côté, l'entraînent vers les objets extérieurs, et qui, de l'autre, n'appartenant proprement qu'à elle, semblent lui circonscrire un espace étroit dont elles ne lui permettent pas de sortir. De tous les objets qui nous affectent par leur présence, notre propre corps est celui dont l'existence nous frappe le plus, parce qu'elle nous appartient plus intimement; mais à peine sentonsnous l'existence de notre corps, que no us nous apercevons de l'attention qu'il exige de nous, pour écarter les dangers qui l'environnent. Sujet à mille besoins, et sensible au dernier point à l' action des corps extérie urs, il serait bientôt détruit si le soin de sa conservation ne nous occupait. Ce n'est pas que tous les corps extérieurs nous fassent éprouver des sensations désagréables, quelques-uns semblent nous dédommager par le plaisir que leur action nous procure; mais tel est le malheur de ia condition humaine, que la douleur est en nous le sentiment le plus vif: le plaisir nous touche moins qu'elle, et ne suffit presque jamais pour nous en consoler. En vain quelques philosophes soutenaient, en retenant leurs cris au milieu des souffrances, que la douleur n'était point un mal; en vain quelques autres plaçaient le bonheur suprême dans la volupté, à laquelle ils ne laissaient pas de se refuser par la crainte de ses suites: tous auraient mieux connu notre nature s'ils s'étaient contentés de borner à l'exemption de la douleur le souverain bien de la vie présente, et de convenir que, sans pouvoir atteindre à ce souverain bien, il nous était seulement permis d'en approcher plus ou moins, en proportion de nos soins et de notre vigilance. Des réflexions si naturelles frapperont infailliblement tout homme abandonné à lui-même et libre des préjugés, soit d'éducation, soit d'étude: elles seront la suite de la première impression qu'il recevra des objets, et on peut les mettre au rang de ces premiers mouvements de l'âme, précieux pour les vrais sages, et dignes d'être observés par eux, mais négligés ou rejetés par la philosophie ordinaire, dont ils démentent presque toujours les principes. La necessité de garantir notre propre corps de la douleur et de la destruction nous fait examiner, parmi les objets extérieurs, ceux qui peuvent nous être utiles ou nuisibles, pour rechercher les uns et fuir les autres. Mais à peine commencons-nous à parcourir ces objets, que nous découvrons parmi eux un grand nombre d'êtres qui nous paraissent entièrement semblables à nous, c'est-à-dire dont la forme est toute pareille à la nôtre, et qui, autant gue nous en pouvons juger au premier coup d'oeil, semblent avoir les mêmes perceptions que nous; tout nous porte donc à penser qu'ils ont aussi les mêmes besoins que nous éprouvons, et, par conséquent, le même intérêt à les satisfaire, d'où il résulte que nous devons trouver beaucoup d'avantage à nous unir avec eux pour démêler dans la nature ce qui peut nous conserver ou nous nuire. La communication des idées est le principe et le soutien de cette union, et dem an de nécessairem ent l'invention des signes: telle est l'origine de la formation des sociétés avec laquelle les langues ont dû naître. Ce commerce, que tant de motifs puissants nous engagent à former avec les autres hommes, augmente bientôt l'étendu de nos idées, et nous en fait naître de très nouvelles pour nous, et de très éloignées, selon toute apparence, de celles que nous aurions eues par nous-mêmes sans un tel secours. C'est aux philosophes à juger si cette communication réciproque, jointe à la ressemblance que nous apercevons entre nos sensations et celles de nos semblables, ne contribue pas beaucoup à former ce penchant invincible que nous avons à supposer l'existence de tous les objets qui nous frappent. Pour me renfermer dans mon sujet, je remarquerai seulement que l'agrément et l'avantage que nous trouvons dans un pareil commerce, soit à faire part de nos idées aux autres hommes, soit à joindre les leurs aux nôtres, doit nous porter à resserrer de plus en plus les liens de la société commencée, et à la rendre la plus utile pour nous qu'il est possible. Mais chaque membre de la société, cherchant ainsi à augmenter pour lui-même l'utilité qu'il en retire, et ayant à combattre dans chacun des autres membres un empressement égal, tous ne peuvent avoir la même part aux avantages, quoique tous y aient le même droit. Un droit si légitime est donc bientôt enfreint par ce droit barbare d'inégalité, appelé loi du plus fort, dont l'usagé semble nous confondre avec les animaux, et dont il est pourtant si difficile de ne pas abuser. Ainsi, la force, donnée par la nature à certains hommes, et qu'ils ne devraient sans doute employer qu'au soutien et à la protection des faibles, est, au contraire, l'origine de l'oppression de ces derniers. Mais plus l'oppression est violente, plus ils la souffrent imp atiem me nt, parce qu'ils sentent que rien n'a dû les y assujettir. De là la notion de l'injuste, et, par conséquent, du bien et du mal moral, dont tant de philosophes ont cherché le principe, et que le cri de la nature, qui retentit dans tout homme, fait entendre chez les peuples même les plus sauvages. De là aussi cette loi naturelle que nous trouvons au dedans de nous, source des premières lois que les hommes ont dû former; sans le secours même de ces lois, elle est quelquefois assez forte, sinon pour anéantir l'oppression, au moins pour la contenir dans certaines bornes. C'est ainsi que le mal que nous éprouvons par les vices de nos semblables produit en nous la connaissance réfléchie des vertus opposées à ces vices, connaissance précieuse dont une union et une égalité parfaites nous auraient peut-être privés. Par l'idée acquise du juste et de l'injuste, et conséquemment de la nature morale des actions, nous sommes naturellement amenés à examiner quel est en nous le principe qui agit, ou, ce qui est la même chose, la substance qui veut et qui conçoit. Il ne faut pas approfondir beaucoup la nature de notre corps et l'idée que nous en avons pour reconnaitre qu'il ne saurait être cette substance, puisque les propriétés que nous observons dans la matière n'ont rien de commun avec la faculté de vouloir et de penser; d'où il résulte que cet être appelé nous est formé de deux principes de différente nature tellement unis, qu'il règne entre les mouvements de l'un et les affections de l'autre une correspondance que nous ne saurions ni suspendre ni altérer, et qui les tient dans un assujettissement réciproque. Cet esclavage si indépendant de nous, joint aux réflexions que nous sommes forcés de faire sur la nature des deux principes et sur leur imperfection, nous élève à la contemplation d'une intelligence toute-puissante à qui nous devons ce que nous sommes, et qui exige par conséquent notre culte; son existence pour être reconnue, n'aurait besoin que de notre sentiment intérieur, quand même le témoignage universel des autres hommes et celui de la nature entière ne s'y joindraient pas. Il est donc évident que les notions purement intellectuelles du vice et de la vertu, le principe et la nécessité de lois, la spiritualité de l'âme, l' existence de Dieu et nos devoirs envers lui; en un mot, les vérités dont nous avons le besoin le plus prompt et le plus indispensable, sont le fruit des premières idées réfléchies que nos sensations occasionnent. Quelque intéressantes que soient ces premières vérités pour la plus noble portion de nous-mêmes, le corps auquel elle est unie nous ramène bientot à lui par la nécessité de pourvoir à des besoins qui se multiplient sans cesse. Sa conservation doit avoir pour s objet, ou de prévenir les maux qui le menacent, ou de remédier à ceux dont il est atteint. C'est à quoi nous cherchons à satisfaire par deux moyens, savoir: par nos découvertes particulières, et par les recherches des autres hommes; recherches dont notre commerce avec eux nous met à portée de profiter. De là ont dû naître d'abord l'agriculture, la médecine, enfin tous les arts les plus absolument nécessaires. Ils ont été en même temps et nos connaissances primitives, et la source de toutes les autres, même de celles qui en, paraissent très éloignées par leur nature: c'est ce qu'il faut développer plus en détail.
Les premiers hommes, en s'aidant mutuellement de leurs lumières, c'est-à-dire de leurs efforts séparés ou réunis, sont parvenus, peut-être en assez peu de temps, ;i découvrir une partie des usages auxquels ils pouvaient employer les corps. Avides de connaissances utiles, ils ont dû écarter d'abord toute spéculation oisive, considérer rapidement, les uns après les autres, les différents êtres que la nature leur présentait, et les combiner, pour ainsi dire, matériellement, par leurs propriétés les plus frappantes et les plus palpables. A cette première combinaison, il a dû en succéder une autre plus recherchée, mais toujours relative à leurs besoins, et qui a principalement consisté dans une étude plus approfondie de quelques propriétés moins sensibles dans l'altération et la décomposition des corps, et dans l'usage qu'on en pouvait tirer. Cependant, quelque chernin que les hommes dont nous parlons et leurs successeurs aient été capables de faire, excités par un objet aussi intéressant que celui de leur propre conservation, l'expérience et l'observation de ce vaste univers leur ont fait rencontrer bientôt des obstacles que leurs plus grands efforts n'ont pu franchir. L'esprit, accoutumé à la méditation, et avide d'en tirer quelque fruit, a dû trouver alors une espèce de ressource dans la découverte des propriétés des corps uniquement curieuse, découverte qui ne connaît point de bornes. En effet, si un grand nombre de connaissances agréables suffisait pour consoler de la privation d'une vérité utile, on pourrait dire que l'étude de la nature, quand elle nous refuse le nécessaire, fournit du moins avec profusion à nos plaisirs: c'est une espèce de superflu qui supplée, quoique très imparfaitement, à ce qui nous manque. De plus, dans l'ordre de nos besoins et des objets de nos passions, le plaisir tient une des premières places, et la curiosité est un besoin pour qui sait penser, surtout lorsque ce désir inquiet est animé par une sorte de dépit de ne pouvoir entièrement se satisfaire. Nous devons donc un grand nombre de connaissances simplement agréables à l'impuissance malheureuse où nous sommes d'acquérir celles qui nous seraient d'une plus grande necessité. Un autre motif sert à nous soutenir dans un pareil travail: si l'utilité n'en est pas l'objet, elle peut en être au moins le prétexte. Il nous suffit d'avoir trouvé quelquefois un avantage réel dans certaines connaissances, où d'abord nous ne l'avions pas soupconné, pour nous autoriser à regarder toutes les recherches de pure curiosité comme pouvant un jour nous êtres utiles. Voilà l'origine et la cause d/es progrès de cettevaste science, appelée en général physique ou étude de la nature, qui comprend tant de parties différentes: l'agriculture et la médecine, qui l'ont principalement fait naître, n'en sont plus aujourd'hui que des branches. Aussi, quoique les plus essentielles et les premières de toutes, elles ont été plus ou moins en honneur à proportion qu'elles ont été plus ou moins étouffées et obscurcies par les autres. Dans cette étude que nous faisons de la nature, en partie par nécessité, en partie par amusement, nous remarquons que les corps ont un grand nombre de propriétés, mais tellement unies pour la plupart dans un même sujet, qu'afin de les étudier chacune plus à fond, nous sommes obligés de les considérer séparément. Par cette opération de notre esprit, nous découvrons bientôt des propriétés qui paraissent appartenir à tous les corps, comme la faculté de se mouvoir ou de rester en repos, et celle de se communiquer du mouvement, sources des principaux changements que nous observons dans la nature. L'examen de ces propriétés, et surtout de la dernière, aidé par nos propres sens, nous fait bientôt découvrir une autre propriété dont elles dépendent; c'est l'impénétrabilité ou cette espèce de force par laquelle chaque corps en exclut tout autre du lieu qu'il occupe, de manière que deux corps, rapprochés le plus qu'il est possible, ne peuvent jamais occuper un espace moindre que celui qu'ils remplissaient étant désunis. L'impénétrabilité est la propriété principale par laquelle nous distinguons les corps des parties de l'espace indéfini où nous imaginons qu'ils sont placés; du moins c'est ainsi que nos sens nous font juger, et, s'ils nous trompent sur ce point, c'est une erreur si métaphysique, que notre existence et notre conservation n'en ont rien à craindre et que nous y revenons continuellement, comme malgré nous, par notre manière ordinaire de concevoir. Tout nous porte à regarder l'espace comme le lieu des corps, sinon réel, au moins supposé; c'est en effet par le secours des parties de cet espace considérées comme pénétrables et immobiles, que nous parvenons a nous former l'idée la plus nette que nous puissions avoir du mouvement. Nous sommes donc comme naturellement contraints à distinguer, au moins par l'esprit, deux sortes d'étendue, dont l'une est impénétrable, et l'aut.-e constitue le lieu des corps. Ainsi, quoique l'impénétrabilité entre nécessairement dans l'idée que nous nous formons des poreions de la matière, cependant, comme c'est une propriété relative, c'est-à-dire dont nous n'avons l'idée qu'en examinant deux corps ensemble, nous nous accoutumons bientôt à la regarder comme distinguée de l'étendue, et à considérer celle-ci séparément de l'autre. Par cette nouvelle considération nous ne voyons plus les corps que comme des parties figurées et étendues de l'espace; point de vue le plus général et le plus abstrait sous lequel nous puissions les envisager. Car l'étendue où nous ne distinguerions point de parties figurées ne serait qu'un tableau lointain et obscur, où tout nous échapperait, parce qu'il nous serait impossible d'y rien discerner. La couleur et la figure, propriétés toujours attachées aux corps, quoique variables pour chacun d'eux, nous servent en quelque sorte à les détacher du fond de l'espace; l'une de ces deux propriétés est même suffisante à cet égard: aussi, pour considérer les corps sous la forme la plus intellectuelle, nous préférons la figure à la couleur, soit parce que la figure nous est plus familière étant à la fois connue par la vue et par le toucher, soit parce qu'il est plus facile de considérer dans un corps la figure sans la couleur, que la couleur sans la figure; soit enfin parce que la figure sert à fixer plus aisément, et d'une manière moins vague, les parties de l'espace. Nous voilà donc conduits à déterminer les propriétés de l'étendue, simplement en tant que figurée. C'est l'objet de la géométrie, qui, pour y parvenir plus facilement, considère d'abord l'étendue limitée par une seule dimension, ensuite par deux, et enfin sous les trois dimensions qui constituent l' essence du corps intelligible, c'est-àdire d'une portion de l'espace terminée en tout sens par des bornes intellectuelles. Ainsi, par des opérations et des abstractions successives de notre esprit, nous dépouillons la matière de presque toutes ses propriétés sensibles pour n'envisager en quelque manière que son fantôme; et on doit sentir d'abord que les découvertes auxquelles cette recherche nous conduit ne pourront manquer d'être fort utiles toutes les fois qu'il ne sera point nécessaire d'avoir égard à l'impénétrabilité des corps; par exemple, lorsqu'il sera question d'étudier leur mouvement en les considérant comme des parties de l'espace, figurées, mobiles, et distantes les unes des autres. L'examen que nous faisons de l'étendue figurée nous présentant un grand nombre de combinaisons à faire, il est nécessaire d'inventer quelque moyen qui nous rende ces combinaisons plos faciles; et, comme elles consistent principalement dans le calcul et le rapport des différentes parties dont nous imaginons que les corps géométriques sont formés, cette recherche nous conduit bientôt à l'arithmétique ou science des nombres. Elle n'est autre chose que l'art de trouver d'une manière abrégée l'expression d'un rapport unique qui résulte de la comparaison de plusieurs autres. Les différentes manières de comparer ces rapports donnent les différentes règles de l'arithmétique. De plus, il est bien difficile qu'en réfléchissant sur ces règles, nous n'apercevions pas certains principes ou propriétés générales des rapports par le moyen desquelles nous pouvons, en exprimant ces rapports d'une manière universelle, découvrir les différentes combinaisons qu'on en peut faire. Les résultats de ces combinaisons, réduits sous une forme générale, ne seront, en effet, que des calculs arithmétiques indiqués et représentés par l'expression la plus simple et la plus courte que puisse souffrir leur état de généralité. La science ou l'art de désigner ainsi les rapports est ce qu'on nomme algèbre. Ainsi, quoiqu'il n'y ait proprement de calcul possible que par les nombres, ni de grandeur mesurable que l'étendue (car sans l'espace nous ne pourrions mesurer exactement le temps), nous parvenons, en généralisant toujours nos idées, à cette partie principale des mathématiques, et de toutes les sciences naturelles, qu'on appelle science des grandeurs en général; elle est le fondement de toutes les découvertes qu'on peut faire sur la quantité, c'està-dire sous tout ce qui est susceptible d'augmentation ou de diminution. Cette science est le terme le plus éloigné où la contemplation des propriétés de la matière puisse nous conduire, et nous ne pourrions aller plus loin sans sortir tout à fait de l'univers matériel. Mais telle est la marche de l' esprit dans ses recherches, qu'après avoir généralisé ses perceptions jusqu'au point de ne pouvoir plus les décomposer davantage, il revient ensuite sur ses pas, recompose de nouveau ces perceptions mêmes, et en forme peu à peu et par gradation les êtres réels qui sont l'objet immédiat et direct de nos sensations. Ces êtres immédiatement relatifs à nos besoins, sont aussi ceux qu'il nous importe le plus d'étudier; les abstractions mathématiques nous en facilitent la connaissance; mais elles ne sont utiles qu'autant qu'on ne s'y borne pas. C'est pourquoi, ayant en quelque sorte épuisé par les spéculations géométriques les propriétés de l'étendue figurée, nous commençons par lui rendre l'impénétrabilité, qui constitue le corps physique, et qui était la dernière qualité sensible dont nous l'avions dépouillé. Cette nouvelle considération entraîne celle de l'action des corps les uns sur les autres, car les corps n'agissent qu'en tant qu'ils sont impénétrables; et c'est de là que se déduisent les lois de l'équilibre et du mouvement, objet de la mécanique. Nous étendons même nos recherches jusqu'au mouvement des corps animés par des forces ou causes motrices inconnues, pourvu que, la loi suivant laquelle ces causes agissent soit connue ou supposée l'être. Rentrés enfin tout à fait dans le monde corporel, nous apercevons bientôt l'usage que nous pouvons faire de la géométrie et de la mécanique pour acquérir,, sur les prop riétés d es corps , l es connaissances les plus variées et les plus profondes. C'est à peu près de cette manière que sont nées toutes les sciences appelées physico-mathématiques. On peut mettre à leur tête l'astronomie, dont l'étude, après celle de nousmêmes, est la plus digne de notre application par le spectacle magnifique qu'elle nous présente. Joignant l'observation au calcul, et les éclairant l'un par l'autre, cette science détermine avec une exactitude digne d'admiration les distances et les mouvements les plus compliqués des corps célestes; elle assigne jusqu'aux forces mêmes par lesquelles ces mouvements sont produits ou altérés. Aussi peut-on la regarder à juste titre comme l'application la plus sublime et la plus sûre de la géométrie et de la mécanique réunies; et ses progrès comme le monument le plus incontestable du succès auquel l'esprit humain peut s'elever par ses efforts. L'usage des connaissances mathématiques n'est pas moins grand dans l'examen des corps terrestres qui nous environnent. Toutes les propriétés que nous observons dans ces corps ont entre elles des rapports plus ou moins sensibles pour nous: la connaissance ou la découverte de ces rapports est presque toujours le seul objet auquel il nous soit permis d'atteindre, et le seul par conséquent que nous devions nous proposer. Ce n'est donc point par des hypothèses vagues et arbitraires que nou`s pouvons espérer de connaître la nature, c'est par l'étude réfléchie des phénomènes, par la comparaison que nous ferons des uns avec les autres, par l'art de réduire, autant qu'il sera possible, un grand nombre de phénomènes à un seul qui puisse en être regardé comme le principe. En effet, plus on diminue le nombre des principes d'une science, plus on leur donne d'etendue; puisque l'objet d'une science étant nécessairement déterminé, les principes appliqués à cet objet seront d'autant plus féconds qu'ils seront en plus petit nombre. Cette réduction, qui les rend d'ailleurs plus faciles à saisir, constitue le véritable esprit systématique, qu'il faut bien se garder de prendre pour l'esprit de système, avec lequel il ne se rencontre pas toujours. Nous en parlerons plus au long dans la suite. Mais, à proportion que l`objet qu'on embrasse est plus ou moins difficile et plus ou moins vaste, la réduction dont nous parlons est plus ou moins pénible: on est donc aussi plus ou moins en droit de l'exiger de ceux qui se livrent à l'étude de la nature. L'aimant, par exemple, un des corps qui a été le plus étudié, et sur lequel on a fait des découvertes si surprenantes, a la propriété d'attirer le fer, celle de lui communiquer sa vertu, celle de se tourner vers les pôles du monde, avec une variation qui est ellemême sujette à des règles, et qui n`est pas moins étonnante que ne le serait une direction plus exacte; enfin, la propriété de s'incliner en formant avec la ligne horizontale un angle plus ou moins grand, selon le lieu de la terre où il est placé. Toutes ces propriétés singulières, dépendantes de la nature de l'aimant, tiennent vraisemblablement à quelque propriété générale, qui en est l'origine, qui jusqu'ici nous est inconnue, et peut-être le restera longtemps. Au defaut d'une telle connaissance, et des lumières nécessaires sur la cause physique des propriétés de l'aimant, ce serait sans doute une recherche bien digne d'un philosophe que de réduire, s'il était possible, toutes ses propriétés à une seule, en montrant la liaison qu'elles ont entre elles. Mais plus une telle découvette serait utile aux progrès de la physique, plus nous avons lieu de craindre qu'elle ne soit refusée à nos efforts. J'en dis autant d'un grand nombre d'autres phénomènes dont l'enchaînement tient peut-être au système général du monde. La seule ressource qui nous reste donc dans une recherche si pénible, quoique si nécessaire, et même si agréable, c'est d'amasser le plus de faits qu'il nous est possible, de les disposer dans l'ordre le plus naturel, de les rappeler à un certain nombre de faits principaux dont les autres ne soient que des conséquences. Si nous osons quelquefois nous élever plus haut, que ce soit avec cette sage circonspection qui sied si bien à une vue aussi faible que la nôtre. Tel est le plan que nous devons suivre dans cette vaste partie de la physique appelée physique générale et expérimentale. Elle diffère des sciences physico-mathématiques, en ce qu'elle n`est proprement qu'un recueil raisonné d'expériences et d'observations; au lieu que celles-ci, par l'application des calculs mathématiques à l'expérience, déduisent quelquefois d'une seule et unique observation un grand nombre de conséquences qui tiennent de bien près, par leur certitude, aux vérités géométriques. Ainsi une expérience sur la réflexion de la lumière donne toute la catoptrique ou science des propriétés des miroirs; une seule sur la réfraction de la lumière produit l'explication mathématique de l'arc-en-ciel, la théorie des couleurs, et toute la dioptrique ou science des propriétés des verres concaves et convexes; d'une seule observation sur la pression des fluides, on tire toutes les lois de l'équilibre et du mouvement de ces corps; enfin, une expérience unique sur l'accélération des corps qui tombent, fait découvrir les lois de leur chute sur des plans inclinés, et celles du mouvement des pendules. Arrêtons-nous un moment ici, et jetons les yeux sur l'espace que nous venons de parcourir. Nous y remarquerons deux limites où se trouvent, pour ainsi dire, concentrées presque toutes les connaissances certaines accordées à nos lumières naturelles. L'une de ces limites, celle d'où nous sommes partis, est l'idée de nous-mêmes, qui conduit à celle de l'Etre toutpuissant et de nos principaux devoirs. L'autre est cette partie des math ématiqu es qui a pour ob j et les propriétés générales des corps, de l'étendue et de la grandeur. Entre ces deux termes est un intervalle immense, où l'intelligence suprême semble avoir voulu se jouer de la curiosité humaine, tant par les nuages qu'elle y a répandus sans nombre, que par quelques traits de lumière qui semblent s'échapper de distance en distance pour nous attirer. On pourrait comparer l'univers à certains ouvrages d'une obscurité sublime, dont les auteurs, en s'abaissant quelquefois à la portée de celui qui les lit, cherchent à lui persuader qu'il entend tout à peu près. Heureux donc, si nous nous engageons dans ce labyrinthe, de ne point quitter la véritable route! autrement les éclairs destinés a nous y conduire ne serviraient souvent qu'à nous en écarter davantage. Il s'en faut bien d'ailleurs que le petit nombre de connaissances certaines sur lesquelles nous pouvons compter, et qui sont, si on peut s'exprimer de la sorte, reléguées aux deux extrémités de l'espace dont nous parlons, soit suffisant pour satisfaire à tous nos besoins. La nature de l'homme, dont l'étude est si nécessaire, est un mystère impénétrable à l'homme même, quand il n'est éclairé que par la raison seule, et les plus grands génies, à force de réflexions sur une matière si importante, ne parviennent que trop souvent à en savoir un peu moins que le reste des autres hommes. On peut en dire autant de notre existence présente et future, de l'essence de l'Etre auquel nous la devons, et du genre de culte qu'il exige de nous. Rien ne nous est donc plus nécessaire qu'une religion, révélée qui nous instruise sur tant de divers objets. Destinée à servir de supplément à la connaissance naturelle, elle nous montre une partie de ce qui nous était caché; mais elle se borne à ce qu'il nous est absolument nécessaire de connaître: le reste est fermé, pour nous, et apparemment le sera toujours. Quelques vérités à croire, un petit nombre de préceptes à pratiquer, voilà à quoi la religion révélée se réduit: néanmoins, à la faveur des lumières qu'elle a communiquées au monde, le peuple même est plus ferme et plus décidé sur un grand nombre de questions intéressantes, que ne l'ont été toutes les sectes des philosophes. A l'égard des sciences mathématiques, qui constituent la seconde des limites dont nous avons parlé, leur nature et leur nombre ne doivent point nous en imposer. C'est à la simplicité de leur objet qu'elles sont principalement redevables de leur certitude. Il faut même avouer que comme toutes les parties des mathématiques n'ont pas un objet également simple, aussi la certitude proprement dite, celle qui est fondée sur des principes nécessairement vrais et évidents par eux-mêmes, n'appartient ni également ni de la même manière à toutes ces parties. Plusieurs d'entre elles, appuyées sur des principes physiques, c'est-à-dire sur des vérités d'expériences ou sur de simples hypothèses, n'ont pour ainsi dire qu'une certitude d'expérience ou même de pure supposition. Il n'y a, pour parler exactement, que celles qui traitent du calcul des grandeurs et des propriétés générales de l'étendue, c'est-à-dire l'algèbre, la géométrie et la mécanique, qu'on puisse regarder comme marquées au sceau de l'évidence. Encore y a-t-il, dans la lumière que ces sciences présentent à notre esprit, une espèce de gradation, et, pour ainsi dire, de nuance à observer. Plus l'objet qu'elles embrassent est étendu, et considéré d'une manière générale et abstraite, plus aussi leurs principes sont exempts de nuages; c'est par cette raison que la géométrie est plus simple que la mécanique, et l'une et l'autre moins simples que l'algèbre. Ce paradoxe n'en sera point un pour ceux qui ont étudié ces sciences en philosophes; les notions les plus abstraites, celles que le commun des hommes regarde comme les plus inaccessibles, sont souvent celles qui portent avec elles une plus grande lumière; l'obscurité s'empare de nos idées à mesure que nous examinons dans un objet plus de propriétés sensibles. L'impénétrabilité, ajoutée à l'idée de l'étendue, semble ne nous offrir qu'un mystère de plus; la nature du mouvement est une énigme pour les philosophes; le principe métaphysique des lois de la percussion ne leur est pas moins caché; en un mot, plus ils approfondissent l'idée qu'ils se forment de la matière et des propriétés qui la représentent, plus cette idée s'obscurcit et paraît vouloir leur échapper.
Les différentes connaissances, tant utiles qu'agréables, dont nous avons parlé jusqu'ici, et dont nos besoins ont été la première origine, ne sont pas les seules que l'on ait dû cultiver. Il en est d'autres qui leur sont relatives, et auxquelles, par cette raison, les hommes se sont appliqués dans le même temps qu'ils se livraient aux premières. Aussi, nous aurions en même temps parlé de toutes si nous n'avions cru plas à propos et plus conforme à l'ordre philosophique de ce discours d'envisager d'abord sans interruption l'étude générale que les hommes ont faite des corps, parce que cette étude est celle par laquelle ils ont commencé, quoique d'autres s'y soient bientôt jointes. Voici à peu près dans quel ordre ces dernières ont dû se succéder. L'avantage que les hommes ont trouvé à étendre la sphère de leurs idées, soit par leurs propres efforts, soit par le secours de leurs semblables, leur a fait penser qu'il serait utile de réduire en art la manière même d'acquérir des connaissances, et celle de se communiquer réciproquement leurs propres pensées; cet art a donc été trouvé, et nommé logique. Il enseigne à ranger les idées dans l'ordre le plus naturel, à en former la chaîne la plus immédiate, à décomposer celles qui en renferment un trop grand nombre de simples, à les envisager par toutes leurs faces, enfin à les présenter aux autres sous une forme qui les leur rende faciles à saisir. C'est en cela que consiste cette science du raisonnement qu'on regarde avec raison comme la clef de toutes nos connaissances. Cependant il ne faut pas croire qu'elle tienne le premier rang dans l'ordre de l' invention. L'art de raisonner est un présent que la nature fait d'elle-même aux bons esprits, et on peut dire que les livres qui en traitent ne sont guère utiles qu'à celui qui se peut passer d'eux. On a fait un grand nombre de raisonnements justes, longtemps avant que la logique, réduite en principes, apprît à démêler les mauvais, ou même à les pallier quelquefois par une forme subtile et trompeuse.
|

|

| La science de la communication des idées ne se borne pas à mettre de l'ordre dans les idées mêmes; elle doit apprendre encore à exprimer chaque idée de la manière la plus nette qu'il est possible, et par conséquent à perfectionner les signes qui sont destinés à la rendre: c'est aussi ce que les hommes ont fait peu à peu. Les langues, nées avec les sociétés, n'ont sans doute été d'abord qu'une collection assez bizarre de signes de toute espèce, et les corps naturels qui tombent sous nos sens ont été en conséquence les premiers objets que l'on ait désignés par des noms. Mais, autant qu'il est permis d'en juger, les langues, dans cette première formation, destinées à l'usage le plus pressant, ont dû être fort imparfaites, peu abondantes, et assujetties à bien peu de principes certains, et les arts ou les sciences absolument nécessaires pouvaient; avoir fait beaucoup de progrès lorsque les règles de la diction et du style etaient encore à naître. La communication des idées ne souffrait pourtant guère de ce défaut de règles, et même de la disette des mots; ou plutôt elle n'en souffrait qu'autant qu'il était nécessaire pour obliger chacun des hommes à augmenter ses propres connaissances par un travail opiniâtre, sans trop se reposer sur les autres. Une communication trop facile peut tenir quelquefois l'âme engourdie et nuire aux efforts dont elle serait capable.; Qu'on jette les yeux sur les prodiges des aveugles-nés et des sourds et muets de naissance, on verra ce que peuvent produire les ressorts de l'esprit, pour peu qu'ils soient vifs et mis en action par des difficultés à vaincre. Cependant la facilité de rendre et de recevoir des idées par un commerce mutuel ayant aussi de son côté des avantages incontestables, il n'est pas surprenant que les hommes aient cherché de plus en plus à augmenter cette facilité. Pour cela ils ont commencé par réduire les signes aux mots, parce qu'ils sont, pour ainsi dire, les symboles que l'on a le plus aisément sous la main. De plus, I'ordre de la génération des mots a suivi l'ordre des opérations de l'esprit: après les individus, on a nommé les qualités sensibles, qui, sans exister par elles-mêmes, existent dans ces individus, et sont communes à plusieurs; peu à peu l'on est enfin venu à ces termes abstraits, dont les uns servent à lier ensemble les idées, d'autres à désigner les propriétés générales des corps, d'autres à exprimer des notions purement spirituelles. Tous ces termes, que les enfants sont si longtemps à apprendre, ont coûté sans doute encore plus de temps à trouver. Enfin, réduisant l'usage des mots en préceptes, on a formé la grammaire, que l'on peut regarder comme une des branches de la logique. Éclairée par une métaphysique fine et déliée, elle démêle les nuances des idées, apprend à distinguer ces nuances par des signes différents, donne des règles pour faire de ces signes l'usage le plus avantageux, découvre souvent, par cet esprit philosophique qui remonte à la source le tout, les raisons du choix bizarre en apparence qui fait préférer un signe à un autre, et ne laisse enfin à ce caprice national qu'on appelle usage que ce qu'elle ne peut absolument lui ôter. Les hommes, en se communiquant leurs idées, cherchent aussi à se communiquer leurs passions. C'est par l'éloquence qu'ils y parviennent. Faite pour parler au sentiment, comme la logique et la grammaire parlent à l'esprit, elle impose silence à la raison même, et les prodiges qu'elle opère souvent entre les mains d'un seul sur toute une nation sont peut-être le témoignage le plus éçlatant de la supériorité d'un homme sur un autre. Ce qu'il y a de singulier, c'est qu'on ait cru suppléer par des règles à un talent si rare. C'est à peu près comme si on eût voulu réduire le génie en préceptes. Celui qui a prétendu le premier qu'on devait les orateurs à l'art, ou n'était pas du nombre, ou était bien ingrat envers la nature. Elle seule peut creer un homme éloquent; les hommes sont le premier livre qu'ils doivent étudier pour y réussir, les grands modèles sont le second; et tout ce que ces écrivains illustres nous ont laissé de philosophique et de réfléchi sur le talent de l'orateur, ne prouve que la difficulté de leur ressembler. Trop éclairés pour prétendre ouvrir la carrière, ils ne voulaient sans doute qu'en marquer les écueils. A l'égard de ces puérilités pédantesques qu'on a honorées du nom de rhétorique, ou plutôt qui n'ont servi qu'à rendre ce nom ridicule, et qui sont à l'art oratoire ce que la scolastique est à la vraie philosophie, elles ne sont propres qu'à donner de l'éloquence l'idée la plus fausse et la plus barbare. Cependant, quoiqu'on commence assez universellement à en reconnaître l'abus, la possession où elles sont depuis longtemps de former une branche distinguée de la connaissance humaine ne permet pas encore de les en bannir: pour l'honneur de notre discernement, le temps en viendra peut-être un jour. Ce n'est pas assez pour nous de vivre avec nos contemporains et de les dominer. Animés par la curiosité et par l'amour-propre, et cherchant par une avidité naturelle à embrasser à la fois le passé, le présent et l'avenir, nous désirons en même temps de vivre avec ceux qui nous suivront, et d'avoir vécu avec ceux qui nous ont précédés. De là l'origine et l'étude de l'histoire, qui, nous unissant aux siècles passés par le spectacle de leurs vices et de leurs vertus, de leurs connaissances et de leurs erreurs, transmet les nôtres aux siècles futurs. C'est là qu'on apprend à n'estimer les hommes que par le bien qu'ils font, et non par l'appareil imposant qui les environne: les souverains, ces hommes assez malheureux pour que tout conspire à leur cacher la vérité, peuvent eux-mêmes se juger d'avance à ce tribunal intègre et terrible; le témoignage que rend l'histoire à ceux de leurs prédécesseurs qui leur ressemblent est l'image de ce que la postérité dira d'eux. La chronologie et la géographie sont les deux rejetons et les deux soutiens de la science dont nous parlons, l'une place les hommes dans le temps; l'autre les distribue sur notre globe. Toutes deux tirent un grand secours de l'histoire de la terre et de celle des cieux, c'est-à-dire des faits historiques et des observations célestes; est s'il était permis d'emprunter ici le langage des poètes, on pourrait dire que la science des temps et celle des lieux sont filles de l'astronomie et de l'histoire. Un des principaux fruits de l'étude des empires et de leurs révolutions est d' examiner comment les hommes, séparés, pour ainsi dire, en plusieurs grandes familles, ont formé diverses sociétés; comment ces différentes sociétés ont donné naissance aux différentes espèces de gouvernements; comment elles ont cherché à se distinguer les unes des autres, tant par les lois qu'elles se sont données, que par les signes particuliers que chacune a imaginés pour que ses membres communiquassent plus facilement entre eux. Telle est la source de cette diversité de langues et de lois, qui est devenue, pour notre malheur, un objet considérable d'étude. Telle est encore l'origine de la politique, espèce de morale d'un genre particulier et supérieur, à laquelle les principes de la morale ordinaire ne peuvent quelquefois s'accommoder qu'avec beaucoup de finesse et qui, pénétrant dans les ressorts principaux du gouvernement des Etats, démêle ce qui peut les conserver, les affaiblir ou les détruire: étude peutêtre la plus difficile de toutes, par les connaissances qu'elle exige qu'on ait sur les peuples et sur les hommes, et par l'étendue et la variété des talents qu'elle suppose, surtout quand le politique ne veut point oublier que la loi naturelle, antérieure à toutes les conventions particulières, est aussi la première loi des peuples, et que, pour être homme d'État, on ne doit point cesser d'être homme. Voilà les branches principales de cette partie de la connaissance humaine qui consiste ou dans les idées directes que nous avons reçues par les sens, ou dans la combinaison et la comparaison de ces idées, combinaison qu'en général on appelle philosophie. Ces branches se subdivisent en une infinité d'autres dont l'énumération serait immense et appartient plus à l'Encyclopédie même qu'à sa préface.
La première opération de la réflexion consistant à rapprocher et à unir les notions directes, nous avons dû commencer, dans ce discours, par envisager la réflexion de ce côté-là, et parcourir les différentes sciences qui en résultent. Mais l es notions form ées par la co mbinaison des idées primitives ne sont pas les seules dont notre esprit soit capable; il est une autre espèce de connaissances réfléchies dont nous devons maintenant parler: elle consiste dans les idées que nous nous formons à nous-mêmes, en imaginant et en composant des êtres semblables à ceux qui sont l'objet de nos idées directes: c'est ce qu'on appelle l'imitation de la nature, si connue et si recommandée par les anciens. Comme les idées directes qui nous frappent le plus vivement sont celles dont nous conservons le plus aisément le souvenir, ce sont aussi celles que nous cherchons le plus à réveiller en nous par l'imitation de leurs objets. Si les objets agréables nous frappent plus étant réels que simplement représentés, ce qu'ils perdent d'agrément en ce dernier cas est en quelque manière compensé par celui qui résulte du plaisir de l'imitation. A l'égard des objets qui n'exciteraient, étant réels, que des sentiments tristes ou tumultueux, leur imitation est plus agréable que les objets mêmes, parce qu'elle nous place à cette juste distance où nous éprouvons le plaisir de l'émotion sans en ressentir le désordre. C'est dans cette imitation des objets capables d'exciter en nous des sentiments vifs ou agréables, de quelque nature qu'ils soient, que consiste, en général, I'imitation de la belle nature, sur laquelle tant d'auteurs ont écrit sans en donner d'idée nette, soit parce que la belle nature ne se démêle que par un sentiment exquis, soit aussi parce que, dans cette matière, les limites qui distinguent l'arbitraire du vrai ne sont pas encore bien fixées et laissent quelque espace libre à l'opinion. A la tête des connaissances qui consistent dans l'imitation, doivent être placées la peinture et la sculpture, parce que ce sont celles de toutes où l'imitation approche le plus des objets qu'elle représente, et parle le plus directement aux sens. On peut v oindre cet art, né de la nécessité et perfectionné par Le luxe, l'architecture, qui, s'étant élevée par degrés des chaumières aux palais, n'est, aux yeux du philosophe, si on peut parler ainsi, que le masque embelli d'un de nos plus grands besoins. L'imitation de la belle nature y est moins frappante et plus resserrée que dans les deux autres arts dont nous venons de parler; ceux-ci expriment indifféremment et sans restriction toutes les parties de la belle nature, et la représentent telle qu'elle est, uniforme ou variée; l'architecture, au contraire, se borne à imiter, par l'assemblage et l'union des différents corps qu'elle emploie, l'arrangement symétrique que la nature observe plus ou moins sensiblement dans chaque individu, et qui contraste si bien avec la belle variété de tout ensemble. La poésie, qui vient aprés la peinture et la sculpture, et qui n'emploie pour l'imitation que les mots disposés suivant une harmonie agréable à l'oreille, parle plutôt à l'imagination qu'aux sens; elle lui représente d'une manière vive et touchante les objets qui composent cet univers, et semble plutôt les créer que les, peindre par la chaleur, le mouvement et la vie qu'elle sait leur donner. Enfin, la musique, qui parle à la fois à l'imagination et aux sens, tient le dernier rang dans l'ordre de l'imitation: non que son imitation soit moins parfaite dans les objets qu'elle se propose de représenter, mais parce qu'elle semble bornée jusqu'ici à un plus petit nombre d'images, ce qu'on doit moins attribuer à sa nature qu'à trop peu d'invention et de ressource dans la plupart de ceux qui la cultivent. Il ne sera pas inutile de faire sur cela quelques réflexions. La musique qui, dans son origine, était peut-être destinée à ne représenter que du bruit est devenue peu à peu une espèce de discours et même de langue par laquelle on exprime les différents sentiments de l'âme, ou plutôt ses différentes passions. Mais pourquoi réduire cette expression aux passions seules, et ne pas l'étendre, autant qu'il est possible, jusqu'aux sensations mêmes? Quoique les perceptions que nous recevons par divers organes diffèrent entre elles autant que leurs objets, on peut néanmoins les comparer sous un autre point de vue qui leur est commun , c' est-à- dire par la situation de plaisir ou de trouble où elles mettent notre âme. Un objet effrayant, un bruit terrible, produisent chacun en nous une émotion par laquelle nous pouvons, jusqu'à un certain point, les rapprocher, et que nous désignons souvent, dans l'un ou l'autre cas, ou par le même nom ou par des noms synonymes. Je ne vois donc point pourquoi un musicien, qui aurait à peindre un objet effrayant, ne pourrait pas y réussir, en cherchant dans la nature l'espèce de bruit qui peut produire en nous l'émotion la plus semblable à celle que cet objet y excite: j'en dis autant des sensations agréables. Penser autrement, ce serait vouloir resserrer les bornes de l'art et de nos plaisirs. J'avoue que la peinture dont il s'agit exige une étude fine et approfondie des nuances qui distinguent nos sensations; mais aussi ne faut-il pas espérer que ces nuances soient démêlées par un talent ordinaire. Saisies par l'homme de génie, senties par l'homme de goût, aperçues par l'homme d'esprit, elles sont perdues pour la multitude. Toute musique qui ne peint rien n'est que du bruit; et, sans l'h a bitud e, qui dé nature tout, ell e n e fera it guère plus de plaisir qu'une suite de mots harmonieux et sonores dénués d'ordre et de liaison. Il est vrai qu'un musicien attentif à tout peindre nous présenterait, dans plusieurs circonstances, des tableaux d'harmome, qui ne seraient point faits pour des sens vulgaires; mais, tout ce qu'on en doit conclure, c'est qu'après avoir fait un art d'apprendre la musique, on devrait bien en faire un de l'écouter.
|

|

| On peut en général donner le nom d'arts à tout système de connaissances qu'il est permis de réduire à des règles positives, invariables et indépendantes du caprice ou de l'opinion; et il serait permis de dire, en ce sens, que plusieurs de nos sciences sont des arts, étant envisagées par leur côté pratique. Mais comme il; y a des règles pour les opérations de l'esprit ou de l'âme, il y en a aussi pour celles du corps, c'est-à dire pour celles qui, bornées aux corps extérieurs, n'ont besoin que de la main seule pour être exécutées. De là la distinction des arts en libéraux et en mécaniques, et la supériorité qu'on accorde aux premiers sur les seconds. Cette supériorité est sans doute injuste à plusieurs égards. Néanmoins, parmi les préjugés, tout ridicules qu'ils peuvent être, il n'en est point qui n'ait sa raison ou, pour parler plus exactement, son origine; et la philosophie, souvent impuissante pour corriger les abus, peut au moins en démêler la source. La force du corps ayant été le premier principe qui a rendu inutile le droit que tous les hommes avaient d'être égaux, les plus faibles, dont le nombre est toujours le plus grand, se sont joints ensemble pour la réprimer Ils ont donc établi, par le secours des lois et des différentes sortes de gouvernements, une inégalité de convention dont la force a cessé d'être le principe. Cette dernière inégalité étant bien affermie, les hommes, en se réunissant avec raison pour la conserver, n'ont pas laissé de réclarner secrètement contre elle par ce désir de supériorité que rien n'a pu détruire en eux. Ils ont donc cherché une sorte de dédommagement dans une inégalité moins arbitraire; et la force corporelle, enchaînée par les lois, ne pouvant plus offrir aucun moyen de supériorité, ils ont été réduits à chercher dans la différence des esprits un principe d'inégalité aussi naturel, plus paisible et plus utile à la société. Ainsi, la partie la plus noble de notre être s'est en quelque manière vengée des premiers avantages que la partie la plus vile avait usurpés, et les talents de l'esprit ont été généralement reconnus pour supérieurs à ceux du corps. Les arts mécaniques dépendant d'une opération manuelle, et asservis, qu'on me permette ce terme, à une espèce de routine, ont été abandonnés à ceux d'entre les hommes que les préjugés ont placés dans la classe la plus inférieure. L'indigence, qui a forcé ces hommes à s'appliquer à un pareil travail, plus souvent que le goût et le génie ne les y ont entraînés, est devenue ensuite une raison pour les mépriser, tant elle nuit à tout ce qui l'accompagne. A l'égard des opérations libres de l'esprit, elles ont été le partage de ceux qui se sont crus sur ce point les plus favorisés de la nature. Cependant l'avantage que les arts libéraux ont sur les arts mécaniques, par le travail que les premiers exigent de l'esprit, et par la difficulté d'y exceller, est suffisamment compensé par l'utilité bien supérieure que les derniers nous procurent pour la plupart. C'est cette utilité même qui a forcé de les réduire à des opérations purement machinales pour en faciliter la pratique à un plus grand nombre d'hommes. Mais la société, en respectant avec justice les grands génies qui l'éclairent, ne doit point avilir les mains qui la servent. La découverte de la boussole n'est pas moins avantageuse au genre humain que ne le serait à la physique l'explication des propriétés de cette aiguille. Enfin, à considérer en lui-même le principe de la distinction dont nous parlons, combien de savants prétendus dont la science n'est proprement qu'un art rnécanique et quelle différence réelle y a-t-il entre une tête remplie de faits sans ordre, sans usage et sans liaison, et l'instinct d'un artisan réduit à l'exécution machinale? Le mépris qu'on a pour les arts mécaniques semble avoir influé jusqu'à un certain point sur leurs inventeurs mêmes. Les noms de ces bienfaiteurs du genre humain sont presque tous inconnus, tandis que l'histoire de ses destructeurs, c'est-à-dire des conquérants, n'est ignorée de personne. Cependant c'est peut-être chez les artisans qu'il faut aller chercher les preuves les plus admirables de la sagacité de l'esprit, de sa patience et de ses ressources. J'avoue que la plupart des arts n'ont été inventés que peu à peu, et qu'il a fallu une; assez longue suite de siècles pour porter les montres, par exemple, au point de perfection où nous les voyons. Mais n'en est-il pas de même des sciences? combien de découvertes qui ont immortalisé leurs auteurs avaient été préparées par les travaux des siècles précédents, souvent même amenées à leur maturité, au point de ne demander plus qu'un pas à faire? et, pour ne point sortir de l'horlogerie, pourquoi ceux à qui nous devons la fusée des montres, l'échappement et la répétition, ne sont-ils pas aussi estimés que ceux qui ont travaillé successivement à perfectionner l'algèbre? D'ailleurs, si j'en crois quelques philosophes que le mépris de la multitude pour les arts n'a point empêchés de les étudier, il est certaines machines si compliquées, et dont toutes les parties dépendent tellement l'une de l'autre, qu'il est difficile que l'invention en soit due à plus d'un seul homme. Ce génie rare, dont le nom est enseveli dans l'oubli, n'eût-il pas été bien digne d'être placé à côté du petit nombre d'esprits créateurs qui nous ont ouvert dans les sciences des routes nouvelles? Parmi les arts libéraux qu'on a réduits à des principes, ceux qui se proposent l'imitation de la nature ont été appelés beaux-arts, parce qu'ils ont principalement l'agrément pour objet. Mais ce n'est pas la seule chose qui les distingue des arts libéraux plus nécessaires ou plus utiles, comme la grammaire, la logique et la morale. Ces derniers ont des règles fixes et arrêtées, que tout homme peut transmettre à un autre: au lieu que la pratique des beaux-arts consiste principalement dans une invention qui ne prend guére ses lois que du génie; les règles qu'on a écrites sur ces arts n'en sont proprement que la partie mécanique; elles produisent à peu près l'effet du télescope, elles n'aident que ceux qui voient.
Il résulte de tout ce que nous avons dit jusqu'ici que les différentes manières dont notre esprit opère sur les objets et les differents usages qu'il tire de ces objets mêmes sont le premier moyen qui se présente à nous pour discerner en général nos connaissances les unes des autres. Tout s'y rapporte à nos besoins, soit de nécessité absolue, soit de convenance et d'agrément, soit même d'usage et de caprice Plus les besoins sont éloignés ou difficiles à satisfaire, plus les connaissances destinées à cette fin sont lentes à paraître. Quels progrès la médecine n'aurait-elle pas faits aux dépens des sciences de pure spéculation si elle était aussi certaine que la géométrie? Mais il est encore d'autres caractères trés marqués dans la manière dont nos connaissances nous affectent et dans les différents jugements que notre âme porte de ces idées: ces jugements sont désignés par les mots d'évidence, de certitude, de probabilité, de sentiment et de goût. L'évidence appartient proprement aux idées dont l'esprit aperçoit la liaison tout d'un coup; la certitude, à celles dont la liaison ne peut être connue que par le secours d'un certain nombre d'idées intermédiaires, ou, ce qui est la même chose, aux propositions dont l'identité avec un principe évident par lui-même ne peut être découverte que par un circuit plus ou moins long; d'où il s'ensuit que, selon la nature des esprits, ce qui est évident pour l'un peut quelquefois n'être que certain pour un autre. On pourrait encore dire, en prenant les mots d'évidence et de certitude dans un autre sens, que la première est le résultat des opérations seules de l'esprit, et se rapporte aux opérations métaphysiques et mathématiques; et que la seconde est plus propre aux objets physiques, dont la connaissance est le fruit du rapport constant et invariable de nos sens. La probabilité a principalement lieu pour les faits historiques, en général pour tous les événements passés, présents et à venir, que nous attribuons à une sorte de hasard, parce que nous n'en démêlons pas les causes. La partie de cette connaissance qui a pour objet le présent et le passé, quoiqu'elle ne soit fondée que sur le simple témoignage, produit souvent en nous une persuasion aussi forte que celle qui naît des axiomes. Le sentiment est de deux sortes: l'un, destiné aux vérités de morale, s'appelle conscience; c'est une suite de la loi naturelle et de l'idée que nous avons du bien et du mal; et on ,pourrait le nommer évidence du coeur, parce que, tout différent qu'il est de l'évidence de l'esprit attachée aux vérités spéculatives, il nous subjugue avec le même empire. L'autre espèce -de sentiment est particulièrement affectée à l'imitation de la belle nature et à ce qu'on appelle beautés d'expressions. Il saisit avec transport les beautés sublimes et frappantes, démêle avec finesse les beautés cachées, et proscrit ce qui n'en a que l'apparence. Souvent même il prononce des arrêts sévères sans se donner la peine d'en détailler les motifs, parce que ces motifs dépendent d'une foule d'idées difficiles à développer sur-le-champ, et plus encore à transmettre aux autres. C'est à cette espèce de sentiment que nous devons le goût et le génie, distingués l'un de l'autre en ce que le génie est le sentiment qui crée, et le goût, le sentiment qui juge.
Après le détail où nous sommes entrés sur les différentes parties de nos connaissances et sur les caractères qui les distinguent, il ne nous reste plus qu'à former un arbre généalogique ou encyclopédique qui les rassemble sous un même point de vue, et qui serve à marquer leur origine et les liaisons qu'elles ont entre elles. Mais l'exécution n'en est pas sans difficulté. Quoique l'histoire philosophique que nous venons de donner de l'origine de nos idées soit fort utile pour faciliter un pareil travail, il ne faut pas croire que l'arbre encyclopédique doive ni puisse méme être servilement assujetti à cette histoire. Le système général des sciences et des arts est une espèce de labyrinthe, de chemin tortueux où l'esprit s'engage sans trop connaitre la route qu'il doit tenir. Pressé par ses besoins, par ceux du corps auquel il est uni, il étudie d'abord les premiers objets qui se présentent à lui; pénètre le plus avant qu'il peut dans la connaissance de ces objets, rencontre bientôt des difficultés qui l'arrêtent, et, soit par l'espérance ou même par le désespoir de les vaincre, se jette dans une nouvelle route; revient ensuite sur ses pas, franchit quelquefois les premières barrières pour en rencontrer de nouvelles, et, passant d'un objet à un autre, fait sur chacun de ces objets, à différents intervalles et comme par secousses, une suite d'opérations dont la discontinuité est un effet nécessaire de la génération même de ses idees. Mais ce désordre, tout philosophique qu'il est de la part de l'esprit, défigurerait, ou plutôt anéantirait entièrement un arbre encyclopédique dans lequel on voudrait le représenter. D'ailleurs, comme nous l'avons déjà fait sentir au sujet de la logique, la plupart des sciences qu'on regarde comme renfermant les principes de toutes les autres, et qui doivent par cette raison occuper les premières places dans l'ordre encyclopédique, n'observent pas le même rang dans l'ordre généalogique des idées, parce qu'elles n'ont pas été inventées les premières. En effet, notre étude primitive a dû être celle des individus; ce n'est qu'après avoir considéré leurs propriétés particulières et palpables que nous avons, par abstraction de notre esprit, envisagé leurs propriétés générales et communes, et formé la métaphysique et la géométrie; ce n'est qu'après un long usage des premiers signes que nous avons perfectionné l'art de ces signes au point d'en faire une science; ce n'est enfin qu'après une longue suite d'opérations sur les objets de nos idées que nous avons par la réflexion donné des règles à ces opérations mêmes. Enfin, le système de nos connaissances est composé de différentes branches, dont plusieurs ont un même point de réunion; et, comme en partant de ce point, il n'est pas possible de s'engager à la fois dans toutes les routes, c'est la nature des différents esprits qui détermine le choix. Aussi est-il assez rare qu'un même esprit en parcoure à la fois un grand nombre. Dans l'étude de la nature, les hommes se sont d'abord appliqués, tous comme de concert, à satisfaire les besoins les plus pressants; mais, quand ils en sont venus aux connaissances moins absolument nécessaires, ils ont dû se les partager, et y avancer chacun de son côté à peu près d'un pas égal. Ainsi, plusieurs sciences ont été, pour ainsi dire, contemporaines; mais dans l'ordre historique des progrès de l'esprit, on ne peut les embrasser que successivement.
|

|

| Mais, comme dans les cartes générales du globe que nous habitons, les objets sont plus ou moins rapprochés, et présentent un coup d'oeil différent selon le point de vue où l'oeil est placé par le géographe qui construit la carte, de même la forme de l'arbre encyclopédique dépendra du point de vue où l'on se mettra pour envisager l'univers littéraire. On peut donc imaginer autant de systèmes différents de la connaissance humaine que de mappemondes de différentes projections; et chacun de ces systèmes pourra même avoir, à l'exclusion des autres, quelque avantage particulier Il n'est guère de savants qui ne placent volontiers au centre de toutes les sciences celle dont ils s'occupent, à peu ptès comme les premiers hommes se plaçaient au centre du monde, persuadés que l'univers était fait pour eux. La prétention de plusieurs de ces savants, envisagée d'un oeil philosophique, trouverait peut-être, même hors de l'amour-propre, d'assez bonnes raisons pour se justifier. Quoi qu'il en soit, celui de tous les arbres encyclopédiques qui offrirait le plus grand nombre de liaisons et de rapports entre les sciences, méritait sans doute d'être préféré. Mais peut-on se flatter de le saisir? La nature, nous ne saurions trop le répéter, n'est composée que d'individus qui sont l'objet primitif de nos sensations et de nos perceptions directes Nous remarquons, à la vérité, dans ces individus, des propriétés communes par lesquelles nous les comparons, et des propriétés dissemblables par lesquelles nous les discernons; et ces propriétés, désignées par des noms abstraits, nous ont conduits à former différentes classes où ces objets ont été placés. Mais souvent tel objet qui, par une pu plusieurs de ces propriétés, a été placé dans une classe, tient à une autre classe par d'autres propriétés et aurait pu tout aussi bien y avoir place. Il reste donc nécessairement de l'arbitraire dans la division générale. L'arrangement le plus naturel serait celui où les objets se succéderaient par les nuances insensibles qui servent tout à la fois à les séparer et à les unir. Mais le petit nombre d'êtres qui nous sont connus ne nous permet pas de marquer ces nuances. L'univers n'est qu'un vaste océan, sur la surface duquel nous apercevons quelques îles plus ou moins grandes, dont la liaison avec le continent nous est cachée. On pourrait former l'arbre de nos connaissances en les divisant, soit en naturelles et en révélées, soit en utiles et agréables, soit en spéculatives et pratiques, soit en évidentes, certaines, probables et sensibles, soit en connaissances des choses et conn aissances des sign es, et ainsi à l'infini. Nous avons choisi une division qui nous a paru satisfaire tout à la fois le plus qu'il est possible à l'ordre encyclopédique de nos connaissances et à leur ordre généalogique. Nous devons cette division à un auteur célèbre dont nous parlerons dans la suite de ce discours: nous avons pourtant cru devoir faire quelques changements, dont nous rendrons compte. Mais nous sommes trop convaincus de l'arbitraire qui régnera toujours dans une pareille division pour croire que notre système soit l'unique ou le meilleur; il nous suffira que notre travail ne soit pas entièrement désapprouvé par les bons esprits. Nous ne voulons point ressembler à cette foule de naturalistes qu'un philosophe moderne a eu tant de raison de censurer, et qui, occupés sans cesse à diviser les productions de la nature en genres et en espèces, ont consumé dans ce travail un temps qu'ils auraient beaucoup mieux employé à l'étude de ces productions mêmes. Que dirait-on d'un architecte qui, ayant à élever un édifice immense, passerait toute sa vie à en tracer le plan; ou d'un curieux qui, se proposant de parcourir un vaste palais, emploierait tout son temps à en observer l'entrée?
Les objets dont notre âme s'occupe sont ou spirituels ou matériels, et notre âme s'occupe de ces objets ou par des idées directes ou par des idées réfléchies. Le système des connaissances directes ne peut consister que dans la collection purement passive et comme machinale de ces mêmes connaissances; c'est ce qu'on appelle ménoire. La réflexion est de deux sortes, nous l'avons déjà observé: ou elle raisonne sur les objets des idées directes, ou elle les imite. Ainsi la mémoire, la raison proprement dite, et l'imagination sont les trois manières différentes dont notre âme opère sur les objets de ses pensées. Nous ne prenons point ici l'imagination pour la faculté qu'on a de se représenter les objets, parce que cette faculté n'est autre chose que la mémoire même des objets sensibles, mémoire qui serait dans un continuel exercice si elle n'était soulagée par l'invention; des signes. Nous prenons l'imagination dans un sens plus noble et plus précis, pour le talent de créer en imitant. Ces trois facultés forment d'abord les trois divisions générales de notre système, et les trois objets généraux des connaissances humaines; l'histoire, qui se rapporte à la mémoire; la philosophie, qui est le fruit de la raison; et les beaux-arts, que l'imagination fait naître. Si nous plaçons la raison avant l'imagination, cet ordre nous paraît bien fondé et conforme au progrès naturel des opérations de l'esprit: I'imagination est une faculté créatrice, et l'esprit, avant de songer à créer, commence par raisonner sur ce qu'il voit et ce qu'il connaît. Un autre motif qui doit déterminer à placer la raison avant l'imagination, c'est que, dans cette dernière faculté de l'âme, les deux autres se trouvent réunies jusqu'à un certain point, et que ]a raison s'y joint à la mémoire. L'esprit ne crée et n'imagine des objets qu'en tant qu'ils sont semblables à ceux qu'il a connus par des idées directes et par des sensations: plus il s'éloigne de ces objets, plus les êtres qu'il forme sont bizarres et peu agréables. Ainsi, dans l'imitation de la nature, l'invention même est assujettie à certaines règles, et ce sont ces règles qui forment principalement la partie philosophique des beaux-arts, jusqu'à présent assez imparfaite, parce qu'elle nè peut être l'ouvrage que du génie, et que le génie aime mieux créer que discuter. Enfin, si on examine le progrès de la raison dans ses opérations successives, on se convaincra encore qu'elle doit précéder l'imagination dans l'ordre de nos facultés, puisque la raison, par les dernières opérations qu'elle fait sur les objets, conduit en quelque sorte à l'imagination: car ces opérations ne consistent qu'à créer, pour ainsi dire, des êtres généraux, qui, séparés de leur sujet par abstraction, ne sont plus du ressort immédiat de nos sens. Aussi la métaphysique et la géométrie sont, de toutes les sciences qui appartiennent à la raison, celles où l'imagination a le plus de part. J'en demande pardon à nos beaux esprits détracteurs de la géométrie; ils ne se croyaient pas sans doute si près d'elle, et il n'y a peut-être que la métaphysique qui les en sépare. L'imagination, dans un géomètre qui crée, n'agit pas moins que dans un poète qui invente. Il est vrai qu'ils opèrent différemment sur leur objet: le premier le dépouille et l'analyse; le second le compose et l'embellit. Il est encore vrai que cette manière différente d'opérer n'appartient qu'à différentes sortes d'esprits, et c'est pour cela que les talents du grand géomètre et du grand poète-ne se trouveront peut-être jamais ensemble; mais soit qu'ils s'excluent ou ne s'excluent pas l'un l'autre, ils ne sont nullement en droit de se mépriser réciproquement. De tous les grands h om mes de l ' anti quité, Archimède est peut-être celui qui mérite le plus d'être placé à côté d'Homère. J'espère qu'on pardonnera cette digression à un géomètre qui aime son art, mais qu'on n'accusera point d'être admirateur outré, et je reviens à mon sujet. La distribution générale des êtres en spirituels et en matériels fournit la sous-division de trois branches . générales. L'histoire et la philosophie s'occupent également de ces deux espèces d'êtres, et l'imagination ne travaille que d'après les êtres purement matériels: nouvelle raison pour la placer la dernière dans l'ordre de llOS facultés. A la tête des êtres spirituels est Dieu qui doit tenir le premier rang par sa nature et par le besoin que nous avons de le connaître; au-dessous de cet Etre suprême sont les esprits créés, dont la révélation nous apprend l 'existence; ensuite vient l'homme, qui, composé de deux principes, tient par, son âme aux esprits, et par son corps au monde matériel; et enfin ce vaste univers que nous appelons monde corporel ou la nature. Nous ignorons pourquoi l'auteur célèbre, qui nous sert de guide dans cette distribution, a placé la nature avant l'homme dans son système: il semble, au contraire, que tout engage à placer l'homme sur le passage qui sépare Dieu et les esprits d'avec les corps. L'histoire, en tant qu'elle se rapporte à Dieu, renferme ou la révélation ou la tradition, et se divise, sous ces deux points de vue, en histoire sacrée et en histoire ecclésiastique. L'histoire de l'homme a pour objet ou ses actions ou ses connaissances, et elle est par conséquent civile ou littéraire, c'est-àdire se partage entre les grandes nations et les grands génies, entre les rois et les gens des lettres, entre les conquérants et les philosophes. Enfin, l'histoire de la nature est celle des productions innombrables qu'on y observe, et forme une quantité de branches presque égale au nombre de ces diverses productions. Parmi ces différentes branches doit être placé avec distinction l'histoire des arts, qui n'est autre chose que l'histoire des usages que les hommes ont fait des productions de la nature pour satisfaire à leurs besoins ou à leur curiosité. Tels sont les objets principaux de la mémoire. Venons présentement à la faculté qui réfléchit et raisonne. Les êtres, tant spirituels que matériels, sur lesquels elle s'exerce, ayant quelques propriétés générales, comme l' existence, la possibilité, la durée. L'examen de ces propriétés forne d'abord cette branche de la philosophie dont toutes les autres empruntent en partie leurs principes: on la nomme l'ontologie ou science de l'être, ou métaphysique générale. Nous descendons de là aux différents êtres particuliers, et les divisions que fournit la science de ces différents êtres sont formées sur le même plan que celle de l'histoire. La science de Dieu, appelée théologie, a deux branch es. La théologie naturell e n 'a de connaissance de Dieu que celle que produit la raison seule, connaissance qui n'est pas d'une fort grande étendue; la théologie révélée tire de l'histoire sacrée une connaissance beaucoup plus parfaite de cet Etre. De cette même théologie révélée résulte la science des esprits créés. Nous avons cru encore ici devoir nous écarter de notre auteur. Il nous semble que la science, considérée comme appartenant à la raison, ne doit point être divisée, comme elle l'a été par lui, en théologie et en philosophie; car la théologie révélée n'est autre chose que la raison appliquée aux faits révélés: on peut dire qu'elle tient à l'histoire par les dogmes qu'elle enseigne, et à la philosophie par les conséquences qu'elle tire de ces dogmes. Ainsi, séparer la théologie de la philosophie, ce serait arracher du tronc . un rejeton qui de lui-même y est uni. Il semble aussi que la science des esprits appartient bien plus intimement à la théologie révélée qu'à la théologie naturelle. La première partie de la science de l'homme est celle de l'âme, et cette science a pour but ou la con-, naissance spéculative de l'âme humaine, ou celle de ses opérations. La connaissance spéculative de l'âne dérive en partie de la théologie naturelle, et en partie de la théologie révélée, et s'appelle pneumatologie ou métaphysique particulière. La connaissance de ses opérations se subdivise en deux branches, ces opérations pouvant avoir pour objet ou la découverte de la vérité, ou la pratique de la vertu. La découverte de la vérité, qui est le but de la logique, produit l'art de la transmettre aux autres. Ainsi, l'usage que nous faisons de la logique est en partie pour notre propre avantage, en partie pour celui des êtres semblables à nous. Les règles de la morale se rapportent moins à l'homme isolé, et le supposent nécessairement en société avec les autres hommes. La science de la nature n'est autre que celle du corps; mais les corps ayant des propriétés générales qui leur sont communes, telles que l'impénétrabilité, la mobilité et l'étendue, c'est encore par l'étude de ces propriétés que la science de la nature doit commencer. Elles ont, pour ainsi dire, un côté purement intellectuel par lequel elles ouvrent un champ immense aux spéculations de l'esprit, et un côté matériel et sensible par lequel on peut les mesurer. La spéculation intellectuelle appartient à la physique générale, qui n'est proprement que la métaphysique des corps; et la mesure est l' obj et des mathématiques, dont les divisions s'étendent presque à l'infini. Ces deux sciences conduisent à la physique particulière, qui étudie les corps en eux-mêmes, et qui n'a que les individus pour objet. Parmi les corps dont il nous importe de connaître les propriétés, le nôtre doit tenir le premier rang, et il est immédiatement suivi de ceux dont la connaissance est le plus nécessaire à notre conservation: d'où résulte l'anatomie, l'agriculture, la médecine et leurs différentes branches. Enfin, tous les corps naturels soumis à notre examen produisent les autres parties innombrables de la physique raisonnée. La peinture, la sculpture, l'architecture, la poésie, la musique et leurs différentes divisions, composent la troisième distribution générale, qui naît de l'imagination, et dont les parties sont comprises sous le nom beaux-arts. On pourrait aussi les renfermer sous le titre général de peinture, puisque tous les beaùx-arts se réduisent à peindre, et ne diffèrent que par les moyens qu'ils emploient; enfin, on pourrait les rapporter tous à la poésie, en prenant ce mot dans sa signification naturelle, qui n'est autre chose qu'invention ou création. La division générale de nos connaissances suivant nos trois facultés a cet avantage qu'elle pourrait fournir aussi les trois divisions du monde littéraire en érudits, philosophes et beaux-esprits: en sorte qu'après avoir formé l'arbre des sciences on pourrait former sur le même plan celui des gens de lettres. La mémoire est le talent des premiers; la sagacité appartient aux seconds, et les derniers ont l'agrément en partage. Ainsi, en regardant la mémoire comme un commencement de réflexion, et en y joignant la réflexion qui combine et celle qui imite, on pourrait dire, en général, que le nombre plus ou moins grand d'idées réfléchies, et la nature de ces idées, constituent la différence plus ou moins grande qu'il y a entre les hommes; que la réflexion, prise dans le sens le plus étendu qu'on puisse lui donner, forme le caractère de l'esprit, et qu'elle en distingue les différents genres. Du reste, les trois espèces de républiques dans lesquelles nous venons de distribuer les gens de lettres n'ont, pour l'ordinaire, rien de commun que de faire assez peu de cas les unes des autres Le poète et le philosophe se traitent mutuellement d'insensés qui se repaissent de chimères; I'un èt l'autre regardent l'érudit comme une espèce d'avare qui ne pense qu'à amasser sans jouir, et qui entasse sans choix les métaux les plus vils avec les plus précieux; et l'érudit, qui ne voit que des mots partout où il ne lit point des faits, méprise le poète et le philosophe comme des gens qui se croient riches parce que leur dépense excède leurs fonds. C'est ainsi qu'on se venge des avantages qu`on n'a pas. Les gens de lettres entendraient mieux leurs intérêts si, au lieu de chercher à s'isoler, ils reconnaissaient le besoin réciproque qu'ils ont de leurs travaux et les secours qu'ils en tirent. La société doit sans doute aux beaux esprits ses principaux agréments, et ses lumières aux philosophes; mais ni les uns ni les autres ne sentent combien ils sont redevables à la mémoire: elle renferme la matière première de toutes nos connaissances, et les travaux de l'érudit ont souvent fourni au philosophe et au poëte les sujets sur lesquels ils s'exercent. Lorsque les anciens ont appelé les Muses Filles de mémoire, a dit un auteur moderne, ils sentaient peut-être combien cette faculté de notre âme est nécessaire à toutes les autres, et les Romains lui élevaient des temples comme à la Fortune.
Anmerkung:
|

About d'Alembert (ENG)., Om d'Alembert (SWE)
Note: Paragraphs in bold face are not formatted in that way in the source text. This is done here only, for editorial and design purposes. /The Art Bin editor